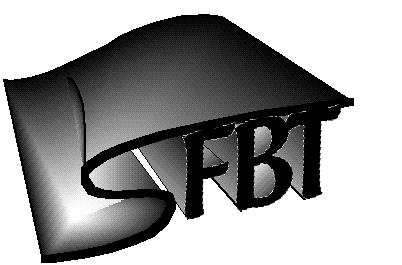
|
Société Francophone de Biologie Théorique French-speaking Society for Theoretical Biology |
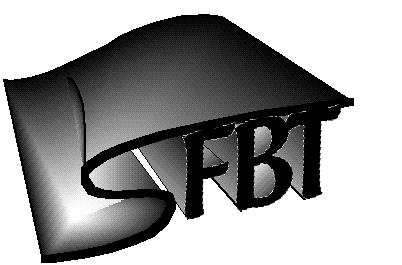
|
Société Francophone de Biologie Théorique French-speaking Society for Theoretical Biology |
Laboratoire de physiologie et génétique végétales, département de biologie,
U.F.R. de recherche scientifique et technique, Université Blaise Pascal (Clermont II),
24 avenue des Landais, F-63177 Aubière cedex
Herbiers universitaires de Clermont-Ferrand, 3 boulevard Lafayette, F-63000 Clermont-Ferrand
Les biologistes ne savent pas toujours très bien
ce que c’est qu’une plante. On a entendu un grand de ce monde demander si
le blé fleurit ; on a pu lire que les mousses sont de petite taille parce
que leur appareil feuillé est haploïde ; que les végétaux ont perdu depuis
longtemps les capacités sensorielles et motrices de leurs ancêtres ; que
chez tous les êtres sexués méiose est synonyme de maturation des gamètes,
que biologie des êtres organisés est synonyme de biologie animale ou encore
que le mot eucaryotes désigne seulement des unicellulaires. La prudence est
de ne faire de reproche à personne, mais puissent ces pages contribuer à
une meilleure compréhension de la végétalité, conçue comme un réseau enchevêtré
de processus aléatoires et de nécessités.
Les critiques seront les bienvenues.
On tente de donner une définition des végétaux, c’est-à-dire de préciser leurs caractères de base. Sont abordées par exemple les notions d’autotrophie et d’hétérotrophie, la notion d’individu, les questions de morphologie et de milieux intérieur et extérieur, la vie végétale par rapport à quelques conditions essentielles de l’environnement, l’existence des dispositifs de type sensoriel et les particularités éthologiques des végétaux. La question reste peut-être de savoir si l'on peut définir la végétalité autrement que par la délimitation du monde végétal par rapport aux animaux et par l'examen des caractères généraux sur lesquels appuyer cette délimitation. Mais notre objectif est de souligner comment dans leur ensemble les différents aspects de la vie végétale sont liés les uns aux autres en un même réseau.
Introduction
La distinction entre bêtes et plantes, entre animaux et végétaux, est ancienne. Or les êtres vivants ont tous les mêmes constituants fondamentaux ; la membrane, le noyau, les mitochondries, le code génétique, les ADN et les ARN, les enzymes, sont semblables, de même que la respiration et les besoins d’énergie. Les virus font exception, en ne possédant pas à la fois ARN et ADN, mais ce ne sont que des sous-êtres vivants. Les naturalistes se plaisent depuis longtemps à montrer les similitudes et l’absence de limites nettes entre les groupes : par exemple la nutrition, la respiration, la croissance, l’aptitude à réagir aux stimulations, la motilité, la sexualité, la reproduction sont des fonctions communes aux végétaux et aux animaux ; le rythme de veille et de sommeil des animaux a son équivalent temporel chez les plantes, les rythmes saisonniers s’observent dans les deux règnes. Dans cet esprit, Édouard Heckel (1875) écrivait : " les différents agents physique et chimique dont nous avons étudié l'influence sur le mouvement provoqué ont une action qui rapproche sensiblement ce phénomène de celui qui existe chez les animaux. " Et Dumortier (1829) : " la force motrice des végétaux réside dans les tissus molluqueux et nullement dans le systême solide, qui ne fait que céder à l'action des tissus molluqueux ; l'on ne peut donc méconnaître qu'il y a analogie de fonctions entre le systême molluqueux des plantes et celui des animaux, puisque [...] dans les deux règnes des corps organiques, le systême molluqueux a la faculté d'attirer et de faire mouvoir le systême solide. ". Qu’est-ce qui est superficiel, qu’est-ce qui mérite d’être pris en considération, dans ces analogies ? et dans les différences, notoires ou non ?
L’exposé qui suit, volontairement fort partiel, présenté selon des choix discutables, ne s’appuie que sur des notions scientifiques très classiques ; le vocabulaire n’est pas celui d’un article de vulgarisation mais ce texte n’apprendra rien à celui qui connaît un peu de biologie végétale : pourtant il soulignera des rapprochements entre certains phénomènes. Il ne s’étendra pas sur les questions d’histoire des sciences, exposées notamment par François Delaporte, qui a réintroduit le mot " végétalité " dans le langage de la réflexion scientifique. Nous nous appuyons sur une vision " matérielle " de la plante, mais en considérant, avec Bünning, que le but de la physiologie est de connaître l’ordre de la nature qui rend possibles les processus vitaux, et à la condition essentielle de ne pas être dupe des mots, nous ne rejetons pas nécessairement le recours occasionnel à ce que Georges Duhamel appelle la connaissance poétique des choses, " qui permet d’entrevoir le sens et la raison profonde des phénomènes de la nature. "
Définition des " règnes "
Conformément aux habitudes, parmi les regna tria naturae Linné distinguait le regnum animale, le regnum vegetabile et le regnum lapideum. Les anciens naturalistes, qui publiaient leurs ouvrages en latin, utilisaient en effet le mot regnum (le royaume). Lorsque l’on s’est mis à publier en langue vulgaire, on a malencontreusement traduit regnum par " règne ", qui à l’époque avait aussi
le sens de " royaume ", à peu près perdu depuis. Cependant, l’image est toujours celle de royaumes ou d’empires (en anglais : kingdom ; en allemand : Reich).
Un autre système de classification consiste, avec Ernst Haeckel, à considérer trois groupes : les unicellulaires permanents ou protistes (procaryotes et eucaryotes), et deux grands types d’organisations pluricellulaires, les végétaux et les animaux. Ce ne serait pas contraire à l’esprit des anciens naturalistes, qui reconnaissaient seulement deux catégories, plantes et bêtes, parce qu’ils n’avaient pas observé les unicellulaires. Mais il y a indiscutablement des protistes à caractères animaux et d’autres à caractères végétaux, protozoaires et protophytes.
Si l’on souhaite considérer des ensembles aussi homogènes que possible, on peut distinguer des compartiments aussi petits que possible : la balkanisation des " royaumes " relève d’une logique cohérente. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire distinguait un " règne humain ", d’éminente dignité. On reconnaît volontiers cinq règnes ou davantage, dans le monde vivant, avec les procaryotes ou monères, ancêtres des protistes eucaryotes, eux-mêmes ancêtres de trois autres règnes, les champignons, les plantes et les animaux ; on subdivise les procaryotes en au moins deux groupes très différents du point de vue des ARN ribosomiques, les archéobactéries, chimiolithotrophes, et les eubactéries. Des regroupements simplificateurs consistent à ranger les protozoaires, les champignons à zoïdes et la totalité des algues, uni et pluricellulaires, dans un même ensemble qu’on appellerait les protistes. Mais rien n’empêche les botanistes professionnels, s’il en reste, de continuer d’étendre leur empire (leur domaine de recherche et d’enseignement) sur les champignons et l’ensemble des algues, même unicellulaires, y compris les " bleues ", et les zoologistes sur l'ensemble des eucaryotes unicellulaires, fussent-ils chlorophylliens. Nous n’entrerons pas dans ces débats qui ressortissent aux corporatismes universitaires de jadis.
On ne se posera pas, ici, de questions sur l’origine phylogénique des groupes ; nous considérerons les êtres vivants actuels selon la manière dont ils se comportent dans la nature actuelle ; les champignons ont plusieurs traits essentiels en commun avec les végétaux proprement dits, alors même que les caractères différentiels sont prépondérants, et nous raisonnerons comme si, dans leur ensemble, ils appartenaient au règne végétal : erreur, assurément, mais que nous présentons comme une approximation ; nous définirons la végétalité comme un mode global de vie, sans nous interroger d’abord sur l’unicité du support moléculaire des éléments de ce mode de vie et sans nous limiter à la simple alternative auto- ou hétérotrophie. Dans cet ordre d’idées, d'excellents auteurs ont longtemps trouvé logique de classer les bactéries parmi les végétaux, et pas seulement les cyanobactéries, à cause de leur paroi rigide : de plus la physiologie de la nutrition oblige à considérer bactéries et plantes supérieures dans un même ensemble biologique, aussi bien comme champ de recherche que dans les programmes d’enseignement ; ces rapprochements sont respectables, bien qu’il ne soit pas vraiment soutenable de grouper eucaryotes chlorophylliens et bactéries dans un même ensemble du point de vue de la systématique des êtres vivants.
Un aspect de la réalité est l’absence de caractères distinctifs absolus entre les règnes, ce qui est dû à l’existence d’exceptions (comme l’orobanche et l’éponge, qui pour autant ne sont évidemment pas des intermédiaires entre animaux et végétaux), à l’existence d’eucaryotes unicellulaires dotés à la fois de caractères animaux et de caractères végétaux (les deux règnes se chevauchent alors) ou à des cas douteux, par exemple variables selon l’éclairement. S'il en ressort un certain flou, ce n’est pas le thème du présent exposé.
La distinction traditionnelle entre végétaux et animaux s’appuyait sur les espèces visibles à l’œil nu. Une chanterelle présente à première vue davantage d’analogies avec une pâquerette qu’avec une hirondelle.
Pour Buffon, tous les êtres vivants avaient la faculté de se reproduire, de croître, de se nourrir. En dehors de la photosynthèse, inconnue comme telle à l’époque, qui ne concerne pas la totalité des végétaux, même parmi les plantes à fleurs, et que l’on observe dans des unicellulaires ayant aussi des caractères animaux, quelles sont les différences les plus visibles entre les deux règnes ? Par degrés seulement, la faculté de se mouvoir, de sentir, de choisir les aliments et de les saisir.
Les naturalistes ont longtemps considéré, en première approximation, le végétal comme caractérisé par sa fixation au sol et par son aptitude à se développer grâce à ses seules ressources aux dépens du monde inanimé ; au contraire, l’animal est capable de se déplacer et se nourrit nécessairement, directement ou non, d’autres êtres vivants ; de plus, il est apte à manifester des activités nerveuses ou psychiques. Cette définition souffre des exceptions, mais si l’on pousse les définitions jusqu'à l’extrême, on débouche sur de la fausse métaphysique. Cependant, sans avoir aucun système nerveux, les plantes possèdent de larges aptitudes aux mouvements, manifestent des ondes de dépolarisation analogues à celles des cellules nerveuses et plusieurs se nourrissent d’aliments déjà élaborés par d’autres êtres vivants, en dehors même des champignons. Plus grave peut-être, ces distinctions s’appuient sur des espèces pluricellulaires, mais elles s’appliquent mal aux unicellulaires et justement toutes les espèces végétales et animales comportent au moins un stade unicellulaire.
Distinction entre végétaux et animaux
Les végétaux se distinguent des animaux par la photosynthèse en ce qui concerne le plus grand nombre d’entre eux, par une cellule organisée de manière très différente et par l’originalité des fonctions de relations, qui affectent à la fois la réception des signaux (les systèmes dits sensoriels) et les effecteurs situés dans le métabolisme, la morphogenèse et la motilité. Il y a là des réseaux d’enchaînements qui se prêtent mal à une présentation linéaire (ne disons pas rectiligne) des faits et qui exigeraient peut-être de recourir à la dislocation de l’exposé par le procédé à la mode des digressions par " encadrés " ou par l’interactivité du disque optique compact à mémoire morte, le compact disc read only memory, en attendant mieux.
Il ne s’agit pas ici de définitions a priori, mais au contraire de chercher sur quels critères il est raisonnable, en dehors peut-être des préoccupations proprement phylogéniques, de distinguer des sous-ensembles dans l’ensemble des êtres vivants tels qu’ils existent actuellement. On peut essayer de définir les végétaux d’une manière globale. En faisant abstraction des cas limites et des cas particuliers, on peut caractériser le végétal d’après plusieurs propriétés, liées les unes aux autres par des relations de nécessité, parfois par des enchaînements de causalités, sans qu’on puisse toujours facilement dire dans quel sens va la relation. On pourra se reporter aux publications de Goldberg, de Kaplan & Hagemann, de Purves, Orians & Heller et de l’American Association of Plant Physiologists.
Il est banal d’imaginer que les végétaux et les animaux actuels dérivent d’ancêtres communs unicellulaires, mobiles, et que l’évolution a séparé le monde vivant entre deux tendances : les animaux, caractérisés par une vie de relations active mais sans autonomie dans leur nutrition (hétérotrophie), et les végétaux, avec une autonomie d’alimentation (autotrophie) accompagnée de quelques nécessités et d’une activité de relations originale à l'égard du milieu extérieur. Le cas des champignons est particulier.
Le végétal unicellulaire est souvent capable d’activités motrices très diverses mais le végétal pluricellulaire se distingue en général par la manière dont il occupe l’espace et par sa fixation mécanique à un substrat. Ceci correspond, en résumé, à une structure cellulaire formée de plusieurs compartiments, dont deux sont propres à la plante (la paroi et les plastes) et dont un troisième l’est dans une large mesure (les vacuoles, qui manquent non seulement chez les animaux, mais aussi chez la plupart des unicellulaires flagellés). Les plastes portent notamment les pigments photoassimilateurs. Les vacuoles permettent une croissance rapide et sont un réservoir essentiel d’eau et d’ions : elles représentent souvent 90 % du volume de la cellule. La paroi, aux fonctions multiples, détermine entre autres la tenue mécanique de l’organisme, grâce à l’accumulation de polymères stables ; la cellulose est caractéristique des végétaux, bien que l’on en rencontre parmi les tuniciers ; le composé azoté que constitue la chitine est surtout connu parmi les arthropodes et les autres organismes hétérotrophes que sont les champignons ; la cellulose consolide la paroi cellulaire, squelette externe de la cellule du végétal qui reste un certain temps extensible et se rigidifie surtout avec le dépôt de lignines ; l’arthropode, quant à lui, dispose d’un squelette externe à l’échelle de l’individu entier.
Les caractères distinctifs classiques du végétal unicellulaire peuvent être schématisés ainsi : organisme à paroi assez rigide, dont la relative rigidité empêcherait toute ingestion d’êtres vivants et d’aliments solides (l’absorption se fait grâce à des gaz ou des liquides qui traversent la paroi et la membrane) ; cela va de pair avec l’aptitude typique de la cellule végétale à synthétiser les composés organiques nécessaires à sa vie, ce qui est plus coûteux que de consommer des aliments élaborés par d’autres. Au contraire, la cellule animale a une structure externe déformable qui permet l’ingestion de proies, condition structurale nécessaire à certains types d’hétérotrophie, l’alimentation à base de proies étant elle-même facilitée par la motricité.
Le végétal pluricellulaire se construit, lui aussi, en cellules à paroi plus ou moins rigide, qui se nourrissent à travers cette paroi ; les plasmodesmes permettent des échanges de cellule à cellule. Pour l’animal pluricellulaire, les cellules absorbantes intestinales et les cellules branchiales ou pulmonaires superficielles, nullement rigides, sont, comme les cellules absorbantes végétales, des cellules " externes ", nous le soulignerons à propos des notions de milieux extérieur et intérieur, mais il y a là une question d’échelle. Signalons également ici les questions de dimensions et de compétition entre organismes, que nous rencontrerons au sujet de la morphologie des plantes.
Autotrophie et hétérotrophie
Si la relative rigidité de la paroi a été proposée comme le critère le plus général de la définition du monde végétal, l’autotrophie, moins générale, en est le caractère métabolique le plus spectaculaire. Sa banalité ne dispense pas de l’évoquer ici.
La plante chlorophyllienne fixe elle-même le carbone qu’elle va incorporer dans ses molécules, à partir de carbone minéral, et l’énergie (d’origine lumineuse) qui sera impliquée dans les processus de son métabolisme : phénomène essentiel pour l’évolution de la biosphère au cours des ères géologiques ; elle est autotrophe à l’égard du carbone. L’animal, non. Certains unicellulaires chlorophylliens placés à l’obscurité deviennent hétérotrophes. Divers micro-organismes, qui relèvent si l’on veut du règne végétal, fixent l’azote moléculaire, N2, provenant de l’atmosphère ; phénomène également essentiel pour la biosphère, les légumineuses profitent de leur symbiose avec les Rhizobium ; la plupart des plantes assimilent l’azote préalablement fixé par les bactéries du sol en fin de compte sous forme nitrique : dans tous ces cas, la plante est dite autotrophe en ce qui concerne l’azote, par là elle se différencie de l’animal : les protéines animales sont édifiées avec des acides aminés qui proviennent, après diverses modifications, des acides aminés des végétaux. Néanmoins, une biosphère qui serait composée exclusivement de plantes vertes, sans bactéries, n’est pas plus concevable que composée exclusivement d’animaux.
Les champignons ne peuvent assimiler que du carbone déjà inclus dans des molécules organiques, mais, en même temps, manquent de l’aptitude à synthétiser certaines vitamines dont ils ont besoin et qu’ils trouvent dans le milieu extérieur (comme si, parasites ou saprophytes se nourrissant dans un milieu qui leur fournit les glucides et les acides aminés nécessaires à leur existence, ils y avaient trouvé de surcroît d’autres substances dont ils auraient perdu, ou n’auraient jamais acquis, l’aptitude à faire eux-mêmes la synthèse). L’hétérotrophie est souvent bien plus compliquée qu’une simple hétérotrophie pour le carbone et l’azote, ce qui conduit à la difficulté d’établir, de manière purement chimique, des milieux artificiels permettant la culture de certaines algues ou de certains champignons (complexe est également l’hétérotrophie des animaux : il y a des gens qui croient que seuls les hommes ont besoin de vitamines et que celles que produisent les végétaux ne servent qu’aux hommes). En outre, dans la plante verte il y a une séparation des activités ; les feuilles sont autotrophes en ce qui concerne le carbone ; les racines absorbent l’azote nitrique ; l’appareil aérien et l’appareil souterrain, du fait de la spécialisation de cellules qui synthétisent des substances différentes, vivent aux dépens l’un de l’autre comme deux organismes complémentaires : on a affaire à une espèce de parasitisme à bénéfices réciproques, c’est-à-dire de symbiose. L’animal, toujours hétérotrophe, ne présente pas cette particularité. Il nous faudra y revenir à propos de la notion d’individu.
Mentionnons pour mémoire les aspects cytologiques évidents de l’autotrophie végétale : d’une part les chloroplastes et les pigments impliqués dans la photosynthèse et d’autre part l’abondance des composés glucidiques dans la cellule végétale, abondance résultant en général de l’aptitude photosynthétique à la synthèse des glucides et aboutissant à la construction de l’enveloppe plus ou moins rigide de la cellule, qui, précisément, rend nécessaire l’alimentation sans prédation que permet la photosynthèse ; ce jeu de rétroactions est une clé du développement du monde végétal. La nutrition azotée et minérale des plantes carnivores dépend d’une activité prédatrice qui met en jeu des phénomènes de mouvements et d’agressivité que nous aurons à envisager plus loin.
Ici pourrait se situer un large développement sur des notions clairement définies par René Heller : le rôle des plantes dans l’installation et le maintien de la biosphère, le rôle pionnier des végétaux dans la conquête des territoires, leur rôle dans la vie aérobie du fait de leur émission d’oxygène, la restauration (abstraction faite des activités humaines) du niveau énergétique de notre planète constamment abaissé par les activités vitales et que seul permet de réaliser le captage de l’énergie solaire par les plantes.
Notion d’individu
La notion d’individu est à peu près claire dans le cas des unicellulaires, végétaux ou animaux. Pour les pluricellulaires, elle ne s’applique guère au monde végétal si l’on réserve le mot individu à son sens initial (indivisible) : les auteurs soucieux de rigueur s’interdisent l’emploi de ce terme (alors que les physiciens fragmentent les " atomes " en particules qui, justement, ne sont plus des " atomes ").
La faculté de régénération, reconstitution spontanée de parties supprimées, existe chez certains animaux. L’hydre d’eau douce, coupée en deux, régénère la partie manquante. On observe le phénomène chez les planaires, les lombrics, les appendices de certains arthropodes, les pattes des amphibiens, etc.
Pour la plante, la faculté de régénération naturelle est très limitée, mais elle a des substituts multiples compatibles avec les propriétés mécaniques des parois et les nécessités qui en découlent. En règle générale il n’y a pas reformation sur place d’un organe enlevé, mais développement d’un organe de remplacement à côté de celui qui a disparu : cas d’un sapin dont la cime est cassée et dont une branche latérale, après levée de la dominance apicale, se redresse et prend le relais dans le développement du tronc ; comportement analogue d’une herbe broutée, ce qui est le sort de nombreux végétaux ; plus proche de la régénération, le cas d’une plante dont on bouture un fragment de tige et qui engendre de nouvelles racines. En se référant à des concepts de macrocytologie, tout cela traduit une certaine faiblesse (réversibilité) de la différenciation et de la diversification des cellules végétales, dont beaucoup restent totipotentes, surtout tant qu’elles sont jeunes.
En première approximation l’animal paraît avoir des cellules irréversiblement différenciées (ce n’est pas absolument vrai), au contraire les cellules végétales différenciées sont souvent capables de se dédifférencier, de reprendre des caractères juvéniles, d’engendrer de nouvelles cellules puis d’évoluer dans une autre direction, en se différenciant à nouveau. La dédifférenciation, qui participe à la totipotence cellulaire, est une particularité essentielle des végétaux ; elle s’oppose à ce qu’il y a d’irréversible dans l’individu animal ; elle donne à la plante une souplesse de développement et de multiplication végétative que l’animal en général ne possède pas. Un cas limite est celui de l’embryogenèse somatique dans les cultures de tissus in vitro ou dans le nucelle des Citrus, clonage spontané sans intervention intracellulaire, à la différence des expériences réalisées chez la brebis.
En ce qui concerne la multiplication par fragmentation de l’organisme, sans passer par la voie sexuée, on sait la provoquer artificiellement ; en culture on la pratique depuis longtemps et de plus en plus (bouturage, greffage, clonage d’arbres fruitiers, micropropagation de plantes horticoles ou d’arbres forestiers etc.). Cependant beaucoup de plantes sont capables de la réaliser naturellement ; ce type de multiplication est peu commun parmi les animaux (des annélides par exemple), mais il est tellement fréquent pour les végétaux que certains botanistes voient là l’origine du terme " multiplication végétative " (en réalité le mot " végétatif " correspond au latin vegetare croître, vegetatio, croissance etc., sans référence particulière aux plantes). Elle est possible notamment grâce aux méristèmes, tissus aux potentialités de type embryonnaire, caractéristiques des plantes. On réserve le mot " reproduction " au cas où il y a sexualité, formation d’un organisme nouveau, encore que les cas non rares de parthénogenèse ou phénomènes apparentés soient ambigus.
Nous nous représentons l’idée d’individu d’après notre propre expérience ; par anthropo- ou zoomorphisme, c’est une notion qui semble évidente. Pourtant il suffit de regarder un fraisier grandir, se développer et couvrir des mètres carrés de terrain pour être plus hésitant. On notera un lien de relative compensation entre l’impossibilité du déplacement des plantes et l’extension, souvent lente mais non nulle, parfois très rapide pour les hydrophytes, que permet la multiplication végétative. Plantefol, suivi par Gorenflot, distinguait les individus d’ordre élémentaire et d’ordre supérieur ; on peut voir là des organismes collectifs, groupant des organismes potentiels susceptibles de vivre même détachés les uns des autres. Le thème de la coexistence d’organes à activités complémentaires, que nous avons considéré précédemment, se complète en effet par cette notion équivoque d’individu. Le monde animal présente des sortes d’organismes collectifs, dans lesquels des individus d’une même espèce sont fixés les uns sur les autres et se différencient en fonction de leur position dans l’ensemble ; c’est le cas, exceptionnel, des " chaînes turriculées " de la crépidule des moules ; les algues vertes, elles aussi, montrent des organisations à plusieurs niveaux : formation de colonies chez les chlorococcales comme l’Hydrodictyon.
L’organisme pluricellulaire animal ou végétal est un ensemble d’organes et de tissus qui vivent en commun et qui s’échangent des substances diverses à rôle trophique ou autre. Mais, alors que l’individu animal est en général défini dès les tout premiers stades de son développement embryonnaire, l’organisme végétal, même au terme de son développement, est beaucoup plus souple ; souvent il suffit de le fragmenter (c’est-à-dire d’annuler un jeu d’interactions) pour permettre la multiplication d’un organisme en plusieurs génétiquement identiques. La zoologie a pu mettre en avant la notion de lignée germinale (la lignée cellulaire qui relie les cellules reproductrices entre elles, de génération en génération) : sans avoir attendu les techniques modernes de la multiplication végétative in vitro, on sait depuis longtemps que cette notion n’a pas de sens chez le bégonia, par exemple, dont un fragment de feuille est capable d’engendrer une plante entière. C’est une des conséquences de l’aptitude à la dédifférenciation.
À propos de la notion d’individu, il faut souligner le cas des greffes. L’animal a une individualité immunitaire telle que l’on ne peut pas facilement lui greffer un organe provenant d’un autre individu ; les plantes au contraire supportent bien plus aisément, quoique de manière limitée aussi, le greffage d’organes provenant même de variétés ou d’espèces différentes.
L’espèce et les variétés
La très grande part de la multiplication asexuée chez les végétaux entraîne une conséquence gênante pour la botanique systématique. La notion d’espèce a d’abord été empiriquement assise sur la description des animaux et des végétaux peuplant la planète, sur les discontinuités éventuellement observables entre les formes vivantes, sur la constance des caractères dans un nombre d’individus jugé suffisant. Mais la notion d’espèce s’appuie aussi (on pourrait dire : exclusivement) sur des caractéristiques génétiques comme l’interfécondité et le maintien des caractères au cours des générations : critères théoriquement accessibles pour les animaux, fréquemment incommodes pour les végétaux (du fait des phénomènes d’auto-incompatibilité qui peuvent empêcher la fécondation entre des organismes que l’on doit néanmoins considérer comme appartenant à une même espèce), le plus souvent non vérifiés, impensables pour les fossiles, dépourvus de sens pour les bactéries. La diversité du monde végétal et du monde animal a été décrite par référence à des entités réellement observées, sortes de " stratégies " adaptatives de la vie, que l’on a toutes appelées " espèces ", mais dont le fondement biologique intime connu n’est certainement pas le même pour toutes. Les innombrables espèces de ronces, pas toujours discontinues, décrites par des systématiciens méticuleux qui y voient parfois des espèces en cours de diversification, sont-elles, au mieux, autre chose que des clones ? Les espèces de champignons basidiomycètes, décrites par dizaines de milliers peut-être, se prêtent difficilement à la culture indispensable à une étude génétique. Que dire des espèces apomictiques du genre Hieracium ? La biodiversité, dont on parle beaucoup, est elle-même multiforme. La biologie moléculaire peut renouveler radicalement la notion de spéciation ; cependant si telle " espèce " de ronce ou de champignon est en fait un clone intérieur à un groupe plus large, est-ce une raison pour lui retirer le rang d’espèce, rang qui lui a été attribué en raison de critères empiriques mais objectifs, pas forcément imaginaires ? Peu importe le mot, mais il est toujours agréable de savoir de quoi l’on parle.
Les processus de l’auto-incompatibilité, fréquents chez les végétaux, favorisent les fécondations croisées, les brassages génétiques ; de ce point de vue ils jouent un rôle de remède à l’égard de l’inaptitude végétale aux déplacements (qui risquerait de trop favoriser l’autofécondation). Rapprochons cela du cas des sélectionneurs-gens d’affaires souhaitant commercialiser des semences qui ne permettent pas à l’exploitant d’utiliser sa propre récolte, comme jadis, pour réensemencer sa terre : situation particulière aux plantes cultivées, le cas des animaux domestiques, unisexués et sans incompatibilité autre que le sexe, étant tout différent sur le plan du marché économique.
Cytologie
La cellule végétale constitue un ensemble extrêmement original d'éléments qui interviennent dans de multiples aspects de la vie, forcément évoqués dans plusieurs parties de cet article. Pour limiter les redondances on mentionnera seulement quelques points.
Les chromosomes des plantes sont accompagnés d'histones, qui manquent aux animaux. Les mitochondries végétales ont des structures beaucoup plus complexes que celles des animaux, comme l'a montré Roland Douce. Le génome mitochondrial des cellules végétales comporte des centaines de milliers de paires de bases, beaucoup plus que celui des cellules animales. Les plantes les plus évoluées sont caractérisées par des séquences non codantes dans leurs ADN, qui manquent chez les ptéridophytes (et chez les animaux) et qui sont très peu présentes chez les bactéries. Tout cela, énoncé ici pour mémoire, de manière beaucoup trop sommaire, est évidemment d'une importance fondamentale et mériterait un examen très poussé.
À un autre niveau, la cellule végétale est compartimentée par un vaste ensemble membranaire (plasmalemme et tonoplaste, évidemment, mais aussi réticulum endoplasmique, citernes et vésicules) qui isole le protoplasme proprement dit d'une phase aqueuse. La phase aqueuse, prédominante chez les plantes, se trouve dans les vacuoles, dans le réticulum, entre les membranes externes et internes des plastes et des mitochondries, etc. C'est de manière assez semblable que le protoplasme est séparé de la vacuole et de l'apoplasme. La situation se présente pratiquement comme si la vacuole et le tonoplaste correspondaient à une invagination du plasmalemme, le contenu vacuolaire étant en quelque sorte une annexe de l'apoplasme. Par exemple dans les cellules accumulatrices de la tige de crosne en train de se tubériser, Mlles Maryse Tort et Marie-Christine Auriac ont montré que le transport des glucides de l'apoplasme (ici : les méats) vers la vacuole se fait directement, sans contact avec le protoplasme : des invaginations du plasmalemme entraînent des gouttes de liquide apoplasmique ; des vésicules se forment ainsi entourées de plasmalemme, elles traversent le protoplasme et passent dans la vacuole en se revêtant d'une deuxième membrane, provenant du tonoplaste ; la double membrane des vésicules se désagrège et le liquide se mêle au suc vacuolaire. Les glucides passent de l’extérieur de la membrane plasmique à l’intérieur de la vacuole sans se mêler au protoplasme, comme dans une sorte de valise diplomatique bénéficiant d’exterritorialité. Du point de vue énergétique, ce processus d'endocytose intravacuolaire est sans aucun doute plus économique que le franchissement direct des deux membranes et du cytoplasme par les molécules glucidiques selon un mécanisme de pompe à proton (constituée d'une ATPase plasmalemmienne) et de cotransport proton-molécule.
Morphologie
À la différence de l’animal, le végétal a un type de développement commandé par l’approximative rigidité des parois, qui fait que la position relative des cellules est presque immuable ; cela entraîne des conséquences importantes.
Les mouvements morphogénétiques sont limités à des organismes dits inférieurs ; Bonner cite quelques exemples : acrasiales, myxomycètes, phycomycètes, basidiomycètes, algues vertes (Hydrodictyon, Pediastrum, volvocales). Pour les plantes dites supérieures, en dehors des mouvements de courbure et des glissements cellulaires, ce qui compte, c’est le grandissement de l’organisme par apposition d’éléments nouveaux, le nombre des mitoses réalisables, l’orientation des mitoses et celle de la croissance cellulaire : voir par exemple les travaux de Lück & Lück.
Les cellules vieillissent et meurent éventuellement, mais souvent leur paroi squelettique, rigide, demeure ; la plante accumule ainsi les cellules mortes ; il n’y a pas de renouvellement cellulaire sur place, pas de remplacement comme chez l’animal, mais addition de cellules vivantes aux cellules devenues mortes. En ce qui concerne la croissance en diamètre, c’est là, pour les cormophytes, un des mécanismes de la croissance indéfinie propre aux végétaux, qui conditionne beaucoup de leurs caractéristiques.
L’addition de cellules nouvelles est le fait des méristèmes ; la dédifférenciation permet parfois aux cellules adultes de changer de rôle. La morphogenèse (les modernes préfèrent morphogénèse) est essentiellement pilotée par les signaux du milieu extérieur et par des jeux de communications, d’interactions : corrélations de croissance ou de différenciation ; les phénomènes locaux de stimulation ou d’inhibition sont primordiaux. La réparation des plaies se déroule chez les plantes selon des modalités liées à ce qui précède : aucun remplacement cellulaire mais par exemple subérification des cellules exposées, ou formation (par dédifférenciation) d’un phellogène donnant un suber cicatriciel, ou encore recouvrement par un bourrelet de tissus secondaires développé à partir du cambium de la bordure de la plaie etc. (Baillaud & Courtot).
En ce qui concerne l’animal, qui vient d’être caractérisé par différence, il est doté d’un caractère supplémentaire, la centralisation unitaire commandée notamment par le système nerveux, les glandes endocrines, la cavité générale, le milieu intérieur liquide, le système circulatoire (dont le circuit fermé n’a pas d’équivalent dans les tissus conducteurs des plantes), caractère indissociable de la stricte délimitation de l’individu, défini par son comportement autonome. Les particularités de son développement dépendent beaucoup moins de ses fonctions de relations avec l’extérieur que celles du végétal.
Les schémas de la morphogenèse, les plans d’organisation des végétaux, sont extrêmement variés dans le monde végétal au sens large, sauf, restriction essentielle, en ce qui concerne les groupes dits supérieurs, assez uniformes ; or ceux-ci, nous le verrons, rassemblent la majorité des espèces.
Les régions histologiques de la plante sont souvent constituées de lignées cellulaires diversifiées, évidemment régies par des mécanismes moléculaires, visualisées par certains alignements, certaines assises et diverses autres dispositions dont la régularité est maintenue par les propriétés mécaniques des parois.
Un trait de l’organisme végétal est la présence de structures répétitives à plusieurs niveaux de l’organisation, parmi les éléments de la cellule (stratification souvent quotidienne observée dans les amyloplastes et les parois cellulaires), dans l’édification des complexes tissulaires (cernes du xylème etc.) ou dans la construction de la tige (comme l’alternance des nœuds et entre-nœuds). Le monde animal montre lui aussi des rythmes spatiaux (métamérisation de l’organisme, dessins du pelage etc.) plus ou moins marqués, parfois masqués par une grande diversification des métamères, mais ceux des végétaux juxtaposent des unités souvent très semblables entre elles construites successivement au cours du temps, aux dépens de cellules méristématiques pour les structures pluricellulaires. L’idée de structures répétitives justifie la notion d’homologies entre feuilles et pièces florales, un peu comme chez les animaux la notion de métamères. En ce qui concerne ces structures répétitives, le végétal peut être approximativement assimilé à une colonie d’organes (de feuilles par exemple) dont chacun vivrait d’abord pour son compte ; cela n’empêche pas les interrelations, notamment celles qui contribuent à la morphogenèse ; au contraire le comportement d’un vertébré n’est possible que grâce, d’abord, à ses particularités unitaires.
La plupart des structures cycliques de la morphologie végétale sont liées à la croissance par addition d’éléments néorformés ; la répétition s’effectue parfois par des emboîtements successifs évoquant des structures fractales (inflorescences et fleurs, ombelles et ombellules, capitules de capitules, frondes plusieurs fois divisées de fougères etc.) Ces cycles résultent souvent d’une différenciation alternée de type binaire, compatible avec des interprétations classiques en termes de biologie moléculaire (Baillaud 1998b, 1999).
Les végétaux, surtout les pluricellulaires, ont en général une structure bipolaire, comme l’animal. Il s’agit essentiellement d’un pôle inférieur et d’un pôle supérieur, pouvant correspondre à la fixation au substrat et au siège de la photosynthèse. Ici encore, c’est la végétalité qui est en cause. Les contraintes du milieu et les particularités fondamentales de la cellule végétale entraînent la nécessité pour la plante d’avoir un développement organisé dans l’espace (en hauteur, en profondeur et en diamètre) et dans le temps (par rapport aux cycles quotidiens et annuels). Nous devrons revenir sur les questions de morphologie à propos des notions de milieux extérieur et intérieur, à propos de la colonisation des milieux terrestres et à propos de la transmission des messages morphogénétiques.
Beaucoup d’auteurs réservent avec raison le mot plante aux végétaux " plantés " en terre, plus généralement aux cormophytes, que l’on appelle, selon les points de vue, les archégoniates ou les embryophytes, c’est-à-dire au règne végétal au sens le plus strict, aux organismes que personne n’a encore soustraits au regnum vegetabile. Pour ces végétaux, la compétition biologique dans une niche écologique donnée ne favorise pas l’organisme qui se déplace le plus vite, comme cela arrive aux animaux, mais celui qui peut grandir plus que les autres, plus haut (compétition pour la lumière), plus loin (branches plagiotropes, racines, rhizomes, stolons) ; la vie de l’organisme est limitée non pas par le territoire qu’il parcourt (et où il se nourrit) mais par ses propres dimensions ; la cellule grandit en se pourvoyant de vacuoles capables de contenir une grande quantité d’eau (l’eau : élément susceptible d’être trouvé sur place et dont l’absorption exige peu d’énergie) ; du fait des méristèmes, se déroule une embryogenèse dite indéfinie ; l’arrêt définitif de la croissance prélude à la mort de la plante autant que la paralysie prélude à la mort de l’animal. Tous ces caractères se tiennent, par des rétroactions positives qui ont pu favoriser l'expansion du monde végétal; ceci est relativement valable aussi bien pour les champignons que pour les végétaux chlorophylliens, mais doit être nuancé, par exemple par la distinction de compétitions inter- et intraspécifiques.
Pour une même masse de matière vivante, le végétal a une surface extérieure, visible, beaucoup plus grande que l’animal (surface très grande qui conditionne l’intensité des échanges avec le milieu extérieur). Dans le langage courant, on parle des animaux qui vivent dans les prés et des plantes, des champignons qui poussent, qui croissent, dans les bois. Les dimensions de la plante en longueur et en surface interviennent souvent de manière positive dans la compétition biologique ; pour l'animal au contraire, une forme conduisant à une faible surface extérieure visible est un facteur d'économie : le rapport de la surface au volume est essentiel. Mais, l'animal cache une énorme surface d’origine externe qu’un observateur superficiel qualifiera d’" interne " (tube digestif, appareil respiratoire).
On voit souvent apparaître la notion d’adaptation. Il nous arrivera d’utiliser le mot " adaptation ", pour désigner le fait de s’adapter aux contraintes de l’environnement ou le fait d’être adapté, sans aucune hypothèse sur le déterminisme de cette adaptation ; certains refusent l’emploi de ce mot qu’ils jugent empreint de finalisme.
Milieu extérieur et milieu intérieur
La forme des végétaux pluricellulaires offre un autre aspect évidemment lié, lui aussi, aux propriétés mécaniques de la cellule : le fait, à l’échelle de l’organisme entier, que la plante absorbe les gaz, l’eau ou les substances dissoutes à travers son tégument, qui est périphérique, alors que l’animal supérieur a ses épithéliums absorbants à l’intérieur de son organisme. Il s’agit de tissus homologues, d’une certaine manière, mais l’animal a réalisé la gastrulation, ce que la consistance des parois, la cohésion des cellules et peut-être d’autres raisons interdisent à la plante ; " un animal est topologiquement un tore, résume Michel Thellier : la lumière du système digestif fait partie de l’extérieur. "
Un phénomène végétal un peu comparable à la gastrulation, mais extrêmement local, se produit dans la genèse de la fleur. Une corolle gamopétale tubuleuse, un ovaire syncarpique, comportent un épiderme retourné en doigt de gant. L’intérieur d’une loge ovarienne est ontogénétiquement externe. Mais il s’agit moins d’un mouvement des cellules déjà formées, comme dans l'embryogenèse animale, que d'un retournement de l’orientation de la multiplication cellulaire. Insistons sur l’importance de l’échelle considérée : du point de vue de la cellule, l’atmosphère interne de la feuille, qui est en communication avec l’atmosphère externe, et celle d’un ovaire floral font partie du milieu exterieur de la plante. L’existence ou non de la gastrulation est un caractère différentiel qui fait corps avec le mode de vie de la plante ou de l’animal, notamment par ses conséquences sur le milieu intérieur, un des supports de l’unité de l’animal. Corrélativement à tout cela, la plante a ses " organes " à l’extérieur, alors que l’animal les a (surtout) à l’intérieur.
Revenons à la notion de milieu intérieur liquide ; chez les animaux celui-ci est extérieur aux cellules, les cellules baignent dedans, comme si l’animal avait pris un peu de milieu marin dans lequel ses cellules puissent vivre. La plante n’a à peu près rien de tel, sauf la présence d’un vacuome parfois très volumineux à l’intérieur de chaque cellule. Nous avons vu que le contenu vacuolaire pouvait être assimilé à une annexe de l'apoplasme : il faut penser à cela lorsque l'on constate que, apoplasme mis à part, c'est la cellule qui héberge, dans sa propre structure mais en dehors de son protoplasme, le milieu aquatique qui lui est indispensable, milieu dont la pression osmotique n'est pas à peu près constante a priori (comme l'eau de mer) ni maintenue constante par homéostasie (comme chez les animaux). La sève même est intérieure aux cellules qui constituent les tissus conducteurs. Cependant les gaz peuvent circuler entre les cellules des plantes supérieures (terrestres ou revenues au cours de l’évolution à un habitat aquatique). Il existe une circulation apoplastique des liquides dans les parois et les méats, mais elle n’est guère comparable à celle du milieu intérieur de l’animal. Ces faits peuvent être rapprochés, souligne René Heller, de " l’importance de l’ion Na+ pour les cellules animales, du rôle que joue la pompe d’efflux à sodium dans la nutrition animale, alors que chez le végétal c’est la pompe à protons qui en a pris le relais : maintien du mécanisme marin chez l’un, acquisition d’un nouveau mécanisme chez l’autre. "
Les aspects chromosomiques : non-exclusivité de la diploïdie et éventualité de la polyploïdie ou de l’haploïdie
Dans la série animale les différences entre gamètes des deux sexes apparaissent assez homogènes ; au contraire chez les végétaux au sens large, y compris les algues et les champignons, la situation est plus floue : les gamètes partenaires sont parfois semblables les uns aux autres, parfois ils diffèrent par leurs dimensions ou leur comportement moteur ou non. Les termes femelle et mâle ne signifient rien d’autre, espèce par espèce, que l’appréciation de la taille et des comportements respectifs des cellules susceptibles de fusionner, et non l’affirmation (pas plus que la négation) d’une homologie, chez l’ensemble des espèces, entre tous les gamètes mâles et tous les gamètes femelles. La situation est normalisée chez les cormophytes, comme elle l’est chez les animaux, signe de " perfection " peut-être, signe d’un terme de l’évolution.
Les animaux effectuent une succession d'étapes, du stade gamète, haploïde, à la gamie et à l'organisme diploïde qui réalise la méiose en donnant des gamètes haploïdes. Le stade haploïde se caractérise par l'inaptitude au développement en dehors d'une fécondation qui fait passer au stade diploïde et qui permet le développement d'un nouvel organisme. Cas particuliers mis à part, comme la parthénogenèse, ce schéma général est respecté de manière stricte par les animaux.
Parmi les plantes, il est assez fréquent, à l'intérieur d'une même espèce, de distinguer plusieurs races qui diffèrent par le nombre de leurs chromosomes ; plus souvent encore c’est le cas de diverses espèces à l’intérieur d’un même genre. Dans une race (ou une espèce) on trouve un certain nombre (pair) de chromosomes ; dans une autre, le double ou le quadruple ; il y a de nombreuses variantes, y compris des cas d’aneuploïdie, c’est-à-dire de garniture chromosomique non multiple exact du nombre haploïde. Des lignées polyploïdes peuvent aussi être obtenues artificiellement ; elles donnent parfois des plantes de taille un peu plus grande que la normale ou à plus grandes fleurs, d’où leur intérêt horticole. La diversification des races et des espèces végétales est souvent liée à de telles variations du nombre des chromosomes. Il arrive également que la plante présente des variations à l'intérieur d'un même organisme : tissus polyploïdes et mutations diverses, génétiques ou somatiques, pouvant se manifester de manière visible par des panachures ou des rameaux mutants ; ceci est facilité par l'éventuelle grande longévité des clones végétaux. Ainsi le niveau de ploïdie est en corrélation avec les capacités de stockage. Dans les tubercules il y a souvent polyploïdie, la quantité d'ADN par cellule étant égale à deux ou quatre fois la normale. Dans les tissus en voie de tubérisation, Mlle Maryse Tort a noté des " amplifications " de l'ADN, accroissements de teneur en ADN très inférieurs à la duplication, considérés comme correspondant à la copie de quelques gènes un très grand nombre de fois ; lorsque ces cellules ont terminé croissance et stockage, une régulation intervient, supprimant l'amplification et ramenant l'ADN cellulaire à un taux normal (tout en conservant sa polyploïdie éventuelle). Il s’ensuit une certaine confusion dans les mots, lorsque, sans autre vérification, mais selon l’usage le plus fréquent, on appelle haploïdie l’état qui succède à la méiose et diploïdie l’état qui succède à la gamie.
En règle générale chez les plantes les gamètes, " haploïdes ", s’unissent en un zygote " diploïde " qui se développe en une plante " diploïde " sur laquelle se déroule la méiose (certains parlent des cellules qui " subissent " la méiose ou la mitose, comme une plante subit l’attaque d’un prédateur : nous ignorons s’il y a une raison logique dans le choix du verbe subir). La méiose donne naissance à des spores " haploïdes ", point de départ d’un nouvel organisme " haploïde ", qui produira les gamètes ; ce processus offre des variantes nombreuses, avec une certaine tendance à la réduction de la génération " haploïde ". Bien qu’il s’agisse de notions des plus classiques, il n’est malheureusement pas inutile de rappeler que les plantes à fleurs elles-mêmes présentent une alternance de générations " haploïdes " et " diploïdes " et que le sac embryonnaire et le grain de pollen sont de véritables organismes pluricellulaires, quoique minuscules et se développant seulement au sein de la plante-mère qui leur a donné naissance. De rappeler aussi que la fécondation des angiospermes fait intervenir deux noyaux femelles et trois noyaux mâles, donnant deux ensembles que l’on peut assimiler à deux organismes distincts, l’un diploïde, l’embryon nouveau-né, l’autre souvent triploïde, l’albumen (ou endosperme secondaire des Allemands et des anglophones), à fonction nutritive, qui disparaîtra sans laisser de descendance.
De son côté, l'haploïdie est souvent compatible avec la formation d'organismes d'apparence normale. De nombreuses espèces d'algues effectuent une alternance de phases haploïdes et diploïdes morphologiquement identiques ; de même, sur un milieu approprié on a pu obtenir, à partir de grains de pollen, des plantes haploïdes, stériles mais morphologiquement à peu près normales, et, à partir d'albumen, des plantes triploïdes.
On peut se demander s’il existe des relations (et lesquelles) entre ces phénomènes et les caractères du monde végétal et du monde animal que nous avons considérés au départ.
La diploïdie a été comparée au cas d’un camion à roues jumelées : une simple crevaison ne suffit pas à provoquer une panne ; la cellule diploïde est plus sûre que la cellule haploïde. La diploïdie autorise la présence de gènes récessifs et permet à l’espèce de disposer d’un abondant patrimoine génique, que l’on est en droit de présumer précieux dans l’évolution. Les animaux peuvent passer pour plus perfectionnés que les végétaux (" en avance " ?), en ce qui concerne ce caractère ainsi supposé favorable à la survie de la descendance.
Ces données montrent l'extrême tolérance du végétal à l'égard des variations du nombre chromosomique (il n'en est pas du tout de même de l'organisme humain, pour lequel un chromosome en surnombre suffit à provoquer des conséquences très graves). D'autre part la brièveté de la croissance de l'animal et les phénomènes immunologiques sont des obstacles à d'éventuelles mutations intérieures à l'organisme. On aperçoit ici une organisation qui est stricte, complexe et centralisée à des degrés très divers selon le " règne ". Une illustration de ce point se trouve dans la fréquence de la multiplication asexuée, que nous avons signalée plus haut au sujet de la notion d’individu chez les plantes et que nous retrouverons à propos de la diversité des espèces.
De la vie aquatique aux terres émergées
La vie a vraisemblablement commencé dans l’eau. Les bactéries, les algues unicellulaires, peuvent se développer sans grandes modifications sur les terres émergées ; les champignons et les lichens sont des cas particuliers. Les végétaux à organisation complexe et les animaux se sont d’abord diversifiés dans l’eau avant de se répandre sur terre. Plusieurs groupes sont retournés, semble-t-il, à l’habitat aquatique de leurs aïeux en conservant de nombreux caractères de l’animalité ou de la végétalité terrestres. Les milieux terrestres diffèrent des milieux aquatiques par des caractères essentiels : l’alimentation en eau et en sels minéraux à puiser dans le sol, l’alimentation en O2, en CO2 et en énergie lumineuse à recueillir dans l’atmosphère, la nécessité qui en découle d’une morphogenèse organisée en une partie souterraine et une partie aérienne, le soutien mécanique de l’eau remplacé par celui du sol pour les organes souterrains mais ne pouvant être assuré que par la plante elle-même pour les organes aériens, la nécessaire protection des organes aériens contre la dessiccation (ou l’aptitude à la reviviscense s’il y a eu déshydratation), des modifications des processus de dispersion.
Pour l’animal, la comparaison entre l’habitat aquatique et la vie terrestre montre des différences importantes dans plusieurs aspects de la biologie : l’appareil respiratoire, l’appareil locomoteur, le squelette (qui, pour les espèces terrestres, non soutenues par la poussée hydrostatique, est proportionnellement d’autant plus massif que l’organisme est plus lourd), la pression artérielle nécessairement d'autant plus haute que l'animal — terrestre — est plus élevé en taille, alors que l’habitat aquatique n’entraîne pas ce besoin) et d’autres systèmes encore.
Dans le cas de la plante terrestre, on observe quelques phénomènes analogues à ceux qui viennent d’être signalés et d’autres plus spécifiques du monde végétal.
La colonisation des terres émergées s’est accompagnée du foisonnement des plantes vasculaires, formées de deux parties essentielles, l’ensemble des racines, fixant la plante au substrat, et l’ensemble des tiges et des feuilles. Ces deux parties vivent en une sorte de symbiose, nous l’avons vu, l’appareil chlorophyllien et les poils racinaires ayant des rôles complémentaires dans la vie de la plante. Hasard ? nécessité en tout cas, cette organisation est associée à un appareil conducteur dont la structure est un marqueur de l’évolution. Les plantes à fleurs, avec leurs vaisseaux vrais à structures de trachées, sont apparues après les ptéridophytes, munies seulement de trachéides, et ont conquis une place plus grande sur la planète. Elles ont permis le développement des vertébrés supérieurs, mais la prolifération des angiospermes entomogames impliquait la venue préalable des arthropodes sur les terres émergées ou, plus précisément, le développement des insectes.
On a parfois, mais pas toujours, l’impression qu’un effort acrobatique est nécessaire pour concevoir dans un esprit néodarwinien les lois de l’évolution exposées par des botanistes comme Henri Gaussen. La loi de récapitulation de la phylogénie par l’ontogénie, de Fritz Müller, fondée sur le cas des animaux, a été soutenue pour les végétaux, par exemple en ce qui concerne la disposition du xylème centripète puis centrifuge, cette dernière étant, à l’évidence, plus favorable à une croissance en diamètre. Dans le même esprit, les botanistes ont pu considérer le pachyte continu, le cylindre libéro-ligneux, comme une coalescence évoluée de faisceaux " primitivement " distincts. La réunion (si elle a effectivement existé) des télomes des ptéridophytes primitives soudés en organes palmés, les feuilles (cf. Herr, 1999), est un facteur d’efficacité dans la réception de l’énergie lumineuse. Mais si la recherche de caractères morphologiques primitifs ou évolués a un sens en paléontologie, la comparaison entre caractères plus ou moins " perfectionnés " est très délicate, parmi les espèces qui coexistent dans notre biosphère actuelle : que restera-t-il de telles considérations lorsque la biologie moléculaire les aura passées au crible de son point de vue ?
La partie aérienne est typiquement assez rigide, soit du fait de la turgescence, des pressions internes agissant sur des organes mous, souvent petits, soit du fait de tissus de soutien, collenchyme ou tissus lignifiés, d’autant plus développés que la plante est plus grande. La partie souterraine (racine, rhizome, bulbe, tubercule) est moins pourvue en tissus de soutien : cela est compensé par le fait qu’elle est soutenue par le sol comme l’animal et l’algue aquatiques par l’eau qui les entoure. Cette organisation mécanique n’est pas particulière aux plantes, les nécessaires implications adaptatives elles-mêmes étant comparables au cas des animaux. On la retrouve chez les plantes vasculaires aquatiques.
La protection contre la dessiccation dans les milieux émergés s’observe aussi bien parmi les animaux que parmi les végétaux, mais les modalités diffèrent. Les animaux terrestres sont munis de tissus de revêtement dont l’étanchéité est efficacement contrôlée. L'habitat terrestre des plantes s'est accompagné de plusieurs dispositifs protecteurs : cuticule foliaire, écailles des bourgeons, liège cortical, enveloppes du pollen, ovules et ovaires clos, ovaires infères, etc. Les tissus méristématiques, fragiles, sont susceptibles d’être endommagés par la dessiccation : on n’est pas surpris de voir le stipe des laminaires s’accroître en diamètre par le jeu d’un méristoderme superficiel, qui ne risque rien, dans l’eau ; au contraire le cambium des gymnospermes et des dicotylédones est toujours situé en profondeur ; cela le protège, mais entraîne une croissance des tissus profonds supérieure à celle des tissus superficiels, situation qui provoque parfois des conséquences mécaniques spectaculaires qu’il est permis de supposer fâcheuses.
J.-L. Bonnemain et C. Dumas soulignent le comportement particulier des gamétophytes, ceux des ptéridophytes exigeant un substrat riche en eau et ceux des phanérogames, surtout ceux des angiospermes, restant inclus dans l’organisme parental, qui les protège contre la dessiccation.
Propres aux plantes les tropismes et les interactions morphogénétiques entre organes, grâce auxquels le système racinaire s’enfonce dans le sol et s’organise dans l’espace souterrain, tandis que l’appareil aérien s’élève et étale ses feuilles, tendant à couper un flux maximal de lumière. C’est toute la morphologie de la plante qui est en cause, d’une manière qui la distingue fondamentalement de l’animal. La dominance apicale se manifeste par l’allongement privilégié de l’axe principal de la plante ; c’est un des processus qui interviennent dans la compétition pour la lumière ; comme l’a souligné l’école de Champagnat, elle est d’autant plus vive que les conditions du milieu sont défavorables : les chances de survie de la plante sont augmentées par une croissance intense permettant à l’apex de gagner éventuellement un milieu moins défavorable ; c’est bien là un caractère de végétalité : à cause de l’immobilité des portions déjà construites, l’avenir de la plante se joue dans le développement de la jeune pousse terminale. Le mycélium des champignons se comporte de manière analogue, signe de " végétalité " de ces organismes, bien que l’on ait le droit de leur refuser le nom de " végétaux " (voir Baillaud 1998a). Remarquons que les plantes de grande taille (les grands arbres) sont beaucoup plus diverses en nombre d’espèces, plus grandes en hauteur, plus abondantes en biomasse totale, et de plus grande longévité que les animaux de grande taille.
Les groupes que l’on peut penser secondairement aquatiques conservent les caractères de la vie terrestre : respiration par exemple pulmonée pour les animaux et, pour les végétaux, pluralité de leur organisation : système racinaire, appareil foliaire orienté par rapport à la lumière, fleurs émergées ; le tissu lacuneux, très développé dans les plantes aquatiques, permet la circulation des gaz dans les organes submergés. Les arbres de la mangrove, vivant dans et sur de l'eau non aérée, présentent des pneumatophores, racines aquatiques dressées atteignant l'atmosphère et jouant un rôle respiratoire. Ici encore on pourrait multiplier les exemples.
Dans l’eau les rencontres sexuelles des êtres vivants, leur dissémination, leur dispersion au sens large, reposent en partie sur les courants ; elles reposent aussi très largement sur l'activité motrice des individus dans le cas des animaux, sur celle des gamètes flagellés pour les animaux et de nombreux végétaux et sur celle des spores flagellées pour les algues.
C'est en milieu terrestre que la différence de ces modes de dispersion (certains préfèrent réserver le mot dissémination aux graines, aux semences) apparaît la plus grande entre les règnes. Les animaux disposent d’une aptitude aux déplacements actifs. Pour les végétaux, il y a transport par le vent des spores des thallophytes, des bryophytes et des ptéridophytes, transport par le vent et les animaux du pollen et des semences des phanérogames, formes de résistance au milieu aérien. On note les nombreux cas où la libération ou l'expulsion des spores, des grains de pollen et des semences met en jeu des mécanismes physiques siégeant dans des cellules mortes (déhiscence des sporanges, des anthères, des gousses et des siliques etc.). Ces processus sont typiques de la végétalité.
La dispersion ainsi réalisée est en partie aléatoire ; les êtres vivants étant, par hypothèse, viables, il est évident qu’ils disposent d’une adaptation efficace de leurs modalités de fécondation, de reproduction et de dispersion, en harmonie avec leurs milieux de vie ; il est remarquable de constater, parmi les espèces végétales, une profusion de spores, de pollen (surtout lorsqu'il est transporté par le vent) et de semences, points de départ de nouveaux organismes. Cela est peut-être plus vrai pour les espèces terrestres que pour les aquatiques, et plus pour les végétaux que pour beaucoup d’animaux. Dans un régime supposé stationnaire, chaque arbre est en moyenne remplacé, à la génération suivante, par la germination d'une seule graine ; un seul grain de pollen suffit à assurer la descendance d'un arbre ; gaspillage, le surplus ? négation de toute finalité ou, à l’opposé, preuve d’une énergie cinétique de l’Évolution allant au-delà de l’optimum, comme dans les faits dits d’hypertélie ? Mais s'il apparaît un mutant produisant davantage encore de pollen ou de graines, il a des chances de l'emporter dans l'escalade de la surenchère néodarwinienne de l'évolution. C’est pourquoi, si toutes les graines du monde donnaient des organismes semblables à leurs plantes mères et ainsi de suite, clones y compris, le diamètre de la Terre aurait tôt fait de grandir à la vitesse de la lumière. On devine quelques facteurs limitants. On se représente difficilement l’incroyable force de la pression de sélection, jouant à la fois sur la reproduction sexuée et sans doute sur la multiplication végétative.
" Stratégies " ?
Le végétal, une fois fixé à un substrat émergé, est confronté à la compétition biologique dans l’adaptation au milieu terrestre lui-même et à un éventail de facteurs externes, physiques ou biologiques, auxquels il est nécessaire qu’il soit adapté : adaptatation par définition peut-on dire, sans laquelle il n’existerait pas ; nous essaierons de présenter brièvement les questions à propos desquelles les botanistes parlent souvent de stratégies : ce terme, à connotation technique, désigne des enchaînements de processus organisés comme s'ils étaient finalisés, mais on ne le dit pas ; cela évite de parler de finalité, notion globale relevant du tabou, à réputation plus purement philosophique.
La situation ressemble à celle du monde animal, à une
différence près, au moins : l’animal possède un système nerveux central,
auquel on peut attribuer bien des phénomènes adaptatifs, voire certains comportements
intentionnels, ce qui n’est pas le cas du végétal. En effet, la question
de la finalité a quelque lien avec celle du prétendu psychisme végétal :
si un phénomène a un but, ce but est-il conscient, intentionnel ? où se situe
l’intention ? dans l’organisme lui-même ou " ailleurs " ?
En simplifiant
les choses nous ramenons l’éventualité de la finalité au choix entre des
locutions telles que " pour que " suivi d’un subjonctif et " de sorte que "
avec l’indicatif. Nous pensons que certains malentendus dans les discussions
proviennent de l’emploi du mot " pourquoi ", ne distinguant pas entre le
" pourquoi " de cause antérieure et le " pour quoi " de but, entre le " warum "
et le " wozu ", appelant les réponses " parce que " ou " pour ". Mais n’essayons
pas de philosopher.
Nous nous garderons de développer les idées présentant l'évolution en cause ici comme animée d'une force capable d'orienter activement la phylogenèse, idée tendant à expliquer les convergences morphologiques et comportementales autrement que par les mutations aléatoires et la sélection (que comprendre lorsque l’on entend que telles cellules des laminaires " annoncent " ou " préfigurent " les tubes criblés des plantes supérieures ?) L'idée de sélection est inévitable : si les " moins adaptés " du point de vue de la survie de la descendance n'étaient pas supplantés, dans une niche écologique donnée ou dans l’ensemble de la biosphère, par les " mieux adaptés " il faudrait revoir le sens des mots. Mais les mutations sont-elles produites au hasard ? C'est une hypothèse habituellement transformée en affirmation. On peut pourtant soutenir qu'une succession de mutations n'aura de valeur sélective différente de zéro que si à chaque génération apparaît une meilleure adaptation dépassant un seuil donné ; c’est une des raisons pour lesquelles certains auteurs introduisent un doute sur l'importance décisive d'un système néodarwinien aveugle de mutations et sélection. Enfin, parmi les végétaux qui vivent actuellement, s’il y a des groupes qui méritent l’épithète primitifs, c’est que l’on admet qu’ils existent sur notre planète depuis plus longtemps que les plus évolués ; ils ont fait leurs preuves depuis plus longtemps : les notions de compétition et d’adaptation exigent beaucoup de précautions d’emploi.
Nous rencontrerons de nouveau ces problèmes ; nous ne chercherons pas à les résoudre, ce n’est pas notre thème.
Le biologiste utilise souvent des termes anthropomorphiques à prendre au second degré, des raccourcis de langage, des " tout se passe comme si ". Il est commode d’assimiler la plante à un " modèle ", c’est-à-dire de la considérer " comme si " c’était un système construit de main d’homme, dont chaque élément aurait une finalité voulue par son fabricant, à la manière des pièces d’une automobile. Bernardin de Saint-Pierre, que l’on a méchamment raillé, décrivait des équilibres biologiques comme d’admirables harmonies de la nature : finalisme mis à part, pourquoi pas ? Mais l’esprit d’action de grâce ne relève pas de la science. Le professeur enthousiaste, émerveillé par la nature, est tenté de s’exprimer comme s’il se mettait non pas, par empathie, à la place de la plante dont il parle, ni à la place du Créateur, ce qu’à Dieu ne plaise, mais devant le concepteur, l’horloger comme disait Voltaire : chacun comprend que c’est seulement une façon de parler. Cependant, devant des familles groupant des plantes lianescentes qui grimpent par des mécanismes divers, on ne peut pas croire que leur " génome " ancestral contenait l’idée de grimper et de chercher par quels moyens ...! Le finalisme est une question à aspects multiples mais le végétaliste ne peut se satisfaire de l’idée que le comportement physiologique de la plante actuelle soit provoqué par une cause future ou par la conscience d’un but à atteindre.
La plante n’a guère plus de " stratégie " consciente que n’en a la goutte de pluie qui écarte les molécules d’air (pour tomber ?) en tombant. Des termes comme signal, alerte, information, communication, sensibilité, message, réponse, rôle, fonction, attaque, lutte, compétition, défense, doivent être compris comme s’il s’agissait des particularités d’un ordinateur ou de systèmes analogues. Il en est de même lorsque l’on écrit que les angiospermes ont inventé le carpelle ou que les lianes ont résolu le problème de la compétition pour la lumière et de la lutte pour la vie. Sous une réserve semblable il nous arrivera de comparer certains comportements de la plante à des réflexes, à des instincts, à des mises en mémoire. D’excellents auteurs, comme Paul-Émile Pilet, clarifient ces problèmes en parlant de la " finalité de fait ", tout en proscrivant le " finalisme ". La référence à un finalisme transcendant est un problème d’un autre ordre.
Fluctuations du milieu : le jour et la nuit
L’organisation de l’être vivant par rapport au jour et à la nuit correspond à des nécessités fondamentalement différentes selon qu’il est chlorophyllien ou qu’il s’agit d’un animal participant à la chaîne alimentaire de la prédation, comme proie ou comme prédateur.
Pour l'organisme chlorophyllien, la photosynthèse est l’élément essentiel de la différence entre le jour et la nuit. Les mouvements des stomates lui sont liés et interviennent dans le renouvellement du CO2 intercellulaire et dans la régulation de la teneur en eau ; la stratification quotidienne de certains éléments cellulaires lui est plus ou moins directement liée elle aussi. Dès 1729 Mairan avait l’intuition d’un " rapport " entre le maintien d’un rythme quotidien de mouvements foliaires en conditions constantes et " cette malheureuse délicatesse d’un grand nombre de malades, qui s’apperçoivent dans leurs lits de la différence du jour & de la nuit ". La similitude de l’organisation temporelle des deux règnes est évidente. Nous avons cependant noté une différence assez fréquente : l’autoentretien des rythmes circadiens est en règle générale de longue durée chez les animaux alors qu’il s’amortit souvent en quelques jours chez les plantes, comme si la présence ou l’absence d’un système nerveux jouait un rôle dans ces phénomènes d’entretien ou d’amortissement d’information ; cela est peut-être la réciproque d’une autre propriété assez fréquente des végétaux, la nécessité d’au moins une impulsion initiale pour que l’oscillation circadienne se déclenche. On pourra se reporter aux publications de Bünning et aussi de Fondeville, Roblin, Greppin, Jerebzoff, Lefèvre & coll., Manachère, Millet.
Pour l’animal, la lumière facilite la recherche de son alimentation ; la vision permet de localiser à distance les objets de manière bien plus précise que l’odorat et l’ouïe ; il s’ensuit que les chances pour les proies d’échapper aux prédateurs sont accrues par le mimétisme ou par l’obscurité. L’animal recherché comme proie a une plus grande probabilité de survie s’il ne se déplace que la nuit.
En dehors des questions touchant à l’alimentation et au métabolisme, les rythmes circadiens des plantes et des animaux répondent à peu près aux mêmes rôles : alternance de temps d’activité et de repos, régulation de la sexualité etc. Les caractéristiques de l’animalité et de la végétalité apparaissent clairement dans les rythmes circadiens de la pollinisation des plantes par les insectes, mettant les deux règnes en présence l'un de l'autre.
Une même activité biologique peut être diurne ou nocturne selon les plantes : adaptation à des variations du milieu extérieur physique (ouverture des stomates le jour ou la nuit, liée à des particularités de la photosynthèse, adaptation aux variations de la température) ou adaptation à différents animaux pollinisateurs (ouverture des fleurs, odeur, etc. en liaison avec la pollinisation par des abeilles, diurnes, ou des papillons crépusculaires, ou de nocturnes chauves-souris). Un cas plus compliqué a été décrit par Willmer & Stone : une fourmi vit sur des acacias ; carnassière, elle dévore les autres insectes qui viennent manger les organes tendres de l’arbre, comme les boutons floraux ; par sa propre recherche de nourriture, la fourmi joue alors un rôle favorable au végétal ; cependant, à l’heure où les fleurs s’ouvrent, celles-ci émettent un signal (chimique et volatil ?) qui éloigne les fourmis et permet aux abeilles pollinisatrices de venir effectuer leur activité.
Les lois d’Aschoff relient à l’intensité lumineuse la période propre des rythmes circadiens ainsi que le rapport du temps d’activité au temps de repos chez les animaux à activité diurne ou à activité nocturne ; on peut se demander s’il y a une équivalence de ces lois dans le règne végétal pour les plantes à photosynthèse en C4 ou à métabolisme acide crassulacéen (CAM) ou encore les plantes à pollinisation zoogame diurne ou nocturne.
Les quatre saisons
La gravité, la pression atmosphérique, la teneur de l’air en oxygène ou en CO2, la lumière, sont des facteurs essentiels de la vie terrestre, mais ne présentent pas, dans les conditions naturelles des latitudes tempérées, de variations saisonnières assez fortes pour que ces variations jouent un rôle de facteurs limitants (rôle de signaux : c’est une autre question). En revanche, humidité et sécheresse, chaleur et froid, sont des facteurs décisifs de vie ou de mort.
Les rythmes saisonniers interviennent chez les êtres vivants de manière peut-être beaucoup plus compliquée et diverse pour les végétaux que pour les animaux, la plante n'ayant pas d'autre possibilité que de rester sur place et de subir tous les aléas de l'environnement, quelles que soient les mutations génétiques éventuelles : un éclairage est apporté par la culture du maïs, qu’on a pu étendre jusqu’à d’assez hautes latitudes en jouant sur la précocité des variétés.
Les caractères qui ont été rappelés plus haut concernant les organes de remplacement des plantes ainsi que la notion d’individu ont des retombées sur le comportement saisonnier. Les facteurs saisonniers agissent comme donneurs de temps sur les rythmes biologiques, en provoquant des réglages qui se trouvent être chaque fois des adaptations aux saisons à venir ; il y a, anticipation du comportement adaptatif, préadaptation ; cette préadaptation à date fixe n’a rien de prémonitoire, ce n’est pas une prescience : en effet elle concerne seulement les variations cycliques du milieu et nullement les aléas météorologiques ; ces remarques valent tout autant pour les rythmes circadiens, elles concernent les animaux autant que les végétaux. Certains animaux migrent à l’occasion des changements de saison, en sorte qu’ils sont, à chaque saison, en un lieu compatible avec leur survie. D’autres ne migrent pas à proprement parler, mais par exemple s’enfoncent dans un terrier protecteur ; le métabolisme peut changer. L’équivalent pour la survie de la plante, ce n’est pas de migrer, mais d’avoir des feuilles qui tombent, parfois les tiges aériennes, d’être limitée aux organes souterrains protégés par le sol ou à des tiges pourvues de bourgeons écailleux protégeant les méristèmes terminaux, ou d’être réduite à une semence. Au printemps, de nouvelles tiges, de nouvelles feuilles, se développent ; les feuilles ne se régénèrent pas sur place, mais il s’agit de tout un ensemble de remplacement, le bourgeon écailleux ou le bulbe donnant une jeune tige portant de nouvelles feuilles. Ceux qui croiraient que ce phénomène est d’une simplicité égale à la clarté d’une belle leçon d’agrégation à l’enchaînement déductif lisse et limpide sont invités à se plonger dans l’ouvrage de Champagnat (1992).
Si l'on envisage les phénomènes saisonniers à partir des facteurs du milieu, dans un esprit de modélisation, " comme si " l’on se mettait à la place d’un ingénieur conscient d’un but à atteindre, on peut proposer la notion de signal, support matériel d'une information, cette dernière ayant un sens dans une vision fonctionnelle du système biologique considéré. Selon les cas, le signal des jours courts ou des nuits fraîches peut provoquer la chute des feuilles ou l'entrée en dormance, mais il peut aussi entraîner la floraison des plantes de jours courts comme les chrysanthèmes ; le froid hivernal peut freiner la croissance, ou bien il peut servir de signal pour la levée de dormance, ou encore c'est le signal qui autorise la mise à fleur ultérieure (vernalisation) ; le réchauffement printanier stimule la croissance, de même que les pluies ; la venue de jours longs autorise la mise à fleur de nombreuses espèces, annuelles ou bisannuelles en particulier ; la sécheresse de l’été est un frein ; le repos de l'hiver peut s'intercaler entre la formation des ébauches florales dans les bourgeons et l'épanouissement printanier des fleurs du pommier ou du muguet ; de multiples signaux jalonnent l'année pour les plantes. Il y a des cas particuliers ; on a constaté une corrélation positive entre la température de juillet et la profondeur de la dormance du prunier.
Les signaux temporels sont à peu près les mêmes pour les animaux, notamment pour les insectes, avec, en plus, les variations saisonnières de l'alimentation. Dans les deux règnes, le support physique du signal saisonnier est souvent tout différent du facteur externe à l'égard duquel l'organisme s'adapte par anticipation ; nous le verrons à propos des dispositifs dits sensoriels de la plante.
Certaines nécessités sont semblables et sont satisfaites de manière analogue chez les plantes et les animaux : par exemple la floraison des plantes à un moment tel que la semence a le temps de mûrir avant la " mauvaise " saison, la naissance des jeunes animaux à un moment tel qu'ils seront assez grands pour survivre à cette " mauvaise " saison. Notons que parmi l’ensemble des organismes se reproduisant plusieurs fois dans leur vie, la régulation photopériodique s’observe surtout chez les animaux ; la floraison des végétaux pérennants est davantage réglée par les fluctuations de la température ; y a-t-il une compensation entre le caractère souvent moins prolifique de l’animal et la rigoureuse précision du signal photopériodique ?
Assez rares sont les cas où l'on a observé l'autoentretien du rythme annuel quand ne sont pas maintenus les repères temporels de type saisonnier, entre autres à cause de la longue durée des expériences nécessaires, mais dans les deux règnes on peut voir des signaux externes déclencher, par automatisme, des enchaînements d'unités comportementales organisées en cycles par la périodicité même des signaux, selon les saisons (rythmes " annuels ", " endogènes annuels ", " circannuels "). Dans la forme temporelle des manifestations, les phénomènes sont semblables à ce que les zoologistes ont appelé " instincts ". Nous reviendrons sur l’" éthologie " végétale.
Mentionnons ici le cycle de la vie et de la mort. La vie, dit-on, est une maladie contagieuse et mortelle : pulvis es, et in pulverem reverteris ; chez l’homme la vie est en général une histoire qui commence bien et qui finit mal ; pour beaucoup d’animaux aussi ; or le cycle de la vie et de la mort est souvent réglé par rapport au cycle des saisons. Dans le règne végétal, la mort programmée des plantes annuelles est synchronisée avec les saisons ; nous admettons qu’elle a une valeur sélective pour la survie de l’espèce considérée dans sa biocénose : le cas des papillons est analogue. De nombreux arbres, de nombreux végétaux pérennants, meurent lorsqu’ils ont atteint un certain âge, une certaine dimension ; la situation est comparable au monde animal. Mais la règle générale est que la plante est souvent potentiellement immortelle. Aspect sexuel du problème : les organes mâles de la plante sont toujours rapidement caducs, cela est lié au fait que chez la plante pérennante, ils se renouvellent périodiquement ; les organes femelles sont caducs aussi mais se développent et protègent la progéniture jusqu’à maturité ; ce sont là des phénomènes typiques de la végétalité (alors que l’animalité se manifestera par la permanence des organes sexuels, par la manducation du mâle par la femelle après l’accouplement chez divers arthropodes, par la discrétion du plumage des oiseaux femelles, camouflage protecteur d’un sexe précieux pour la survie de l’espèce, ou par la longévité moyenne des femmes supérieure à celle des hommes).
Antagonismes et alliances : le camouflage et le mimétisme
La comparaison entre animaux et végétaux conduit à considérer les relations qui se sont nouées entre les uns et les autres : à cause de leur complexité et de l’intérêt qu’ils ont suscité, on accordera ici à certains de ces phénomènes une place disproportionnée par rapport à leur importance, marginale, dans la vie végétale. Le camouflage est un processus rudimentaire ; au contraire le mimétisme met en jeu au moins trois partenaires : un modèle, un imitateur (un mime) et une dupe, l’individu qui est trompé d’une manière favorisant l’imitateur ; la dupe est toujours un animal (sauf, pensons-nous, dans le cas très particulier des zoocécidies). On a décrit une grande diversité de faits de mimétisme proprement animal, dans lesquels le mime aussi est un animal (et parfois le modèle). Nous n’essaierons pas de comparer chacun de ces faits à ceux du mimétisme végétal, c’est-à-dire aux cas où le mime est une plante, que nous allons tenter de présenter pour eux-mêmes très succinctement.
Le mimétisme est longtemps resté du domaine de l’histoire naturelle anecdotique et descriptive. Certains cas relèvent, à l’évidence, du plus simple des hasards et n’incitent pas à mettre en cause une quelconque finalité mystérieuse. Qui n’a été étonné par la ressemblance entre les feuilles des orties et celles de plantes qui vivent souvent groupées avec elles ? L’ortie blanche, l’alliaire, n’appartiennent pas à la famille des urticacées, mais à celles, fort différentes, des labiées et des crucifères : ces plantes inoffensives bénéficient de leur ressemblance avec un sosie redouté, les enfants hésitent à les cueillir. Parmi les mauvaises herbes des moissons (les plantes messicoles), le coquelicot, le bleuet, la nielle, autrefois abondants, devaient leurs chances à des similitudes avec les céréales (hauteur de la plante, date de maturité etc.) : les semences mûres, récoltées en même temps, ne pouvaient être triées par les techniques du dépiquage ; la saison venue, l’agriculteur les semait ensemble. L’ergot des céréales, de sinistre mémoire, est un champignon terriblement vénéneux qui se développe dans l’épi et dont la forme, la consistance et le poids sont autant d’éléments de ressemblance avec la semence cultivée ; la dupe de cette ressemblance est encore l’homme, qui ensemence son champ avec le champignon mortel en même temps qu’avec du bon grain et qui s’intoxique en consommant le pain fait de céréales ergotées.
Dans les lignes qui suivent, le mot dupe sera utilisé comme un raccourci de langage, ne signifiant pas que la tromperie soit consciente de la part de qui que ce soit, mais que " tout se passe comme si ". On clarifie le problème en excluant les simples convergences sans conséquences bien nettes.
Spencer Barrett, qui donne une vue assez complète du phénomène, cite le cas, classique, des fleurs entomogames d’orchidacées mimant la forme d’une femelle d’insecte, ce qui attire l’insecte mâle dupé, qui vient, pratique des pseudocopulations et transporte le pollen d’une fleur à l’autre. La fleur de l’Amorphophallus répand une odeur de charogne qui attire les mouches femelles susceptibles de pondre sur une trompeuse fausse réserve alimentaire pour leurs larves, odeur qui attire aussi les mouches mâles susceptibles de rencontrer là des femelles, le tout aboutissant au transport du pollen de fleur à fleur.
Les plantes à fleurs unisexuées, lorsqu’elles sont anémogames, ont, remarquons-le, des fleurs femelles et des fleurs mâles morphologiquement très différentes ; lorsqu’elles sont entomogames, les fleurs des deux sexes sont généralement semblables : similitude favorable à la fécondation croisée par un même insecte. Le mimétisme, au sens défini plus haut, suppose qu’il y ait une sorte de duperie ; cela se produit pour certaines caricacées, dans lesquelles seules les fleurs mâles produisent du nectar : le papillon pollinisateur visite aussi, on pourrait dire " par erreur ", les fleurs femelles, dans lesquelles il ne trouve ni pollen ni nectar mais auxquelles il apporte le pollen récolté auparavant.
Ces phénomènes nous rappellent ce que nous avons dit plus haut des " stratégies " et posent des questions qui vont grossièrement du comment au pourquoi (à la causalité antérieure) et au problématique pour quoi (à une supposée " cause finale ", ou plus raisonnablement au rôle, à la valeur sélective) et qui se situent à l’échelle de l’individu actuel, de la vie en société ou de l’évolution ; les faits de mimétisme contraignent à distinguer ces divers plans de la connaissance.
Une fois la ressemblance constatée, on peut chercher si elle joue un rôle avantageux dans la compétition biologique, si elle contribue à la survie de la descendance. A-t-elle un but ? Résulte-t-elle d’une intention ? Méfions-nous des faux problèmes. En tout cas, rien n’autorise à dire que la plante fasse exprès de ressembler à une autre pour tromper un tiers ; si l’on dit qu’une espèce A en imite une autre, B, cela signifie seulement que l'espèce A est favorisée dans sa survie ou son expansion par sa ressemblance avec l'espèce B.
Les aspects temporels de la structure de l’organisme peuvent être aussi importants que ses aspects spatiaux, dans ces problèmes d’adéquation de l’être vivant à l’ensemble des paramètres de son environnement : la notion de mimétisme nous rappelle que l’être vivant a une structure indissociablement spatiale et temporelle, même si les méthodes d’investigation ne sont pas les mêmes pour les divers caractères de cette organisation.
À l’échelle de l’évolution, quels sont les mécanismes qui ont conduit aux faits de mimétisme ?
Un exemple instructif est fourni par la riziculture. Le riz cultivé diffère du riz sauvage par l’aptitude à être consommé (dimension des grains, résistance de l’enveloppe à la mouture). Le désherbage s’impose pour éliminer de la rizière le riz sauvage ; ce désherbage est facilité par des différences morphologiques qui permettent une distinction facile. Mais à la suite de cette opération, on constate une évolution des espèces vers des formes de plus en plus semblables au riz cultivé ; un hybride apparaît, qui germe en même temps que le riz cultivé, qui fleurit en même temps etc., mais ayant les caractères défavorables du sauvage. Une parade : on a obtenu une variété de riz cultivé à feuilles pourpres, facilitant le désherbage ; mais il s’est développé un riz sauvage à feuilles pourpres.
Cet exemple du riz s’accorde avec un mécanisme mutation-sélection : mutation ou pollution génétique, pression de sélection (par l’homme) très élevée ; cela fait penser à la sélection induite chez les pucerons par l’emploi des pesticides ou chez les bactéries par les antibiotiques. Les tenants d’une évolution moins matérialiste auraient beau jeu de se demander si cette microévolution a court terme a des mécanismes identiques à ceux d’une macroévolution à plus long terme. Les orchidacées, avec leurs fleurs et leur biologie extraordinaires à nos yeux, suggèrent des systèmes moins prosaïques ; cependant les fleurs de cette famille présentent une étonnante diversité morphologique, c’est-à-dire, à l’échelle de l’évolution, une immense variabilité que l’on peut supposer aléatoire, dans sa fréquence et ses manifestations. Cette variabilité a pu multiplier les chances d’apparition des ressemblances les plus étranges. Ainsi donc ces aspects mimétiques sont-ils apparus par suite du hasard des mutations ? et se sont-ils maintenus grâce à la seule sélection ? En l’absence d’une approche expérimentale du problème, comment l’affirmer ou le nier autrement que par l’idée que nous nous faisons du bon sens, les uns ou les autres ?
Ce qui précède se rapporte à la question : par quels mécanismes une espèce dotée de telles structures est-elle viable ? ou encore : pourquoi cette espèce est-elle capable d’exister actuellement ? Nous ne chercherons pas ici à répondre à la question : pourquoi existe-t-elle ? Mais le biologiste doit se poser un autre " pourquoi ", un autre " par quels mécanismes ", concernant cette fois la morphogenèse spatiale et temporelle de l’individu ; celui-ci vit dans un milieu donné ; il a son programme génétique, ses protéines, ses enzymes etc. ; à partir de cela se construit un organisme, qui se trouve ressembler à un autre, qui se trouve compétitif et viable ; comprendre ce qu’est un être vivant et par quels ensembles de mécanismes biochimiques et écophysiologiques il s’édifie, selon des processus affinés au travers d’une longue lignée d’ancêtres, comment il interagit avec les autres êtres vivants, est une tâche inachevée.
Ces phénomènes relèvent de la végétalité parce qu’ils concernent la survie des organismes végétaux, peu aptes à se déplacer, cohabitant avec le monde animal, fort dangereux, dont le comportement agit sur l'équilibre entre les espèces végétales. D’ailleurs le danger peut aussi être dans le végétal pour l’animal.
Le camouflage par mimétisme concerne par exemple les " plantes-cailloux " comme les Lithops et les Conophytum, dont l’aspect de cailloux n’attire pas l’attention des ennemis herbivores. Nous reviendrons un peu plus loin sur le camouflage à propos de la sensitive.
Antagonismes et alliances : défense, agressivité, parasitisme et symbiose
Entre procaryotes, algues, champignons, cormophytes et animaux, de multiples combinaisons existent de défense active et d’agressivité, de parasitisme et de symbiose, dont la comparaison détaillée éclairerait les notions d’animalité et de végétalité ; nous réserverons le mot symbiose à des cas de mutualisme. Limitons-nous.
Les épines et les aiguillons jouent un rôle de dissuasion ; c’est peut-être par un hasard filtré par la nécessité que les feuilles du houx sont épineuses seulement à la base de l’arbre ; les poils urticants sont une arme chimique ; le goût amer des gentianes peut être dissuasif à l’égard des herbivores. À long terme, la présence de substances toxiques dans le végétal est une protection évidente, non de l’individu mais de l’espèce, contre les prédateurs. Des poisons à l’égard des oiseaux et des mammifères sont contenus dans le Strychnos nux vomica, les hellébores, l’Urginea scilla ; d’autres plantes contiennent des insecticides, comme le tabac, les pyrèthres, diverses légumineuses etc. ; de nombreuses espèces aromatiques sont seulement insectifuges (voir Lucienne Bézanger-Beauquesne et William S. Bowers).
Le végétal peut aussi être protégé par la voie de la chimie avant d’avoir été brouté. Les antibiotiques des champignons les défendent contre les bactéries. La télétoxie inhibe le développement d’autres plantes dans le voisinage, grâce à des toxines émises dans le sol, agissant à distance. De multiples interactions entre végétaux ont été décrites depuis longtemps (voir Grümmer), se manifestant par exemple dans les alternances d’essences forestières étudiées par R. Moreau & R.A. Schaeffer. La salive de chenilles vivant sur le chou entraîne (Tumlinson & Vet) une libération de bêtaglucosidase qui déclenche l’émission, par la plante, de substances volatiles qui attirent les guêpes susceptibles de pondre leurs œufs dans le corps des chenilles en question. Dans plusieurs cas on a décrit des défenses collectives des plantes contre les agressions animales. La destruction d’une partie du feuillage de certains arbres (peupliers par exemple), comparable à l’attaque par des herbivores, comme des chenilles, est rapidement suivie (Baldwin & coll.) d’une augmentation de teneur en tannins qui rend indigeste le reste du feuillage de l’arbre et la réaction se manifeste aussi dans les arbres voisins de même espèce qui n’ont pas été attaqués. Tout se passe comme si ces derniers étaient informés de l’événement par un message transmis par l’atmosphère.
Les plantes sont capables de résister aux agents pathogènes (virus, bactéries, champignons) par reconnaissance du pathogène puis expression des gènes de défense végétaux (voir Jackson & Taylor). Il peut y avoir reconnaissance de races de pathogènes. Les mécanismes de la reconnaissance du soi et du non-soi sont très proches de ceux de l’auto-incompatibilité dans la reconnaissance du pollen, comparables aux réactions aux stress. Il semble que les mécanismes immunologiques, propres aux animaux, soient apparus postérieurement aux mécanismes végétaux.
L’agressivité du végétal, c’est-à-dire son aptitude à attaquer un autre être vivant, de manière plus ou moins directe, se manifeste par diverses formes de parasitisme, l’hôte étant en général un autre végétal : vie parasitaire ou hémiparasitaire de phanérogames comme les cuscutes, les orobanches, le gui, de nombreux champignons. La plante grimpante, qui s’appuie mécaniquement sur une plante support, parvient de ce fait à grandir plus vite qu’elle avec " économie de matière " et se trouve favorisée dans la compétition pour la lumière ; elle n’opère aucun prélèvement de substance, mais nous la considérons comme une sorte de parasite (cleptoparasitisme) ; il y a quelque similitude avec l’arbre qui germe à l’abri d’un buisson qu’il domine par la suite et fait disparaître : on pense au coucou. Les plantes carnivores vivent aux dépens du monde animal, grâce à des pièges fort divers souvent animés de mouvements rapides ; exceptionnelle, cette hétérotrophie agressive sort du modèle proprement végétal habituel.
Diverses symbioses trophiques (parasitismes à bénéfice réciproque) associent des végétaux, au sens large, entre eux ou avec des procaryotes. Le cas le plus général est celui de l’endosymbiose cellulaire : les mitochondries et les plastes, avec leur continuité génétique et leur génome propre, apparaissent comme des bactéries phagocytées et domestiquées par des cellules eucaryotes primitives ; les bactéries transformées en mitochondries sont devenues leur appareil respiratoire, tandis que les cyanobactéries capturées ont pris forme et fonctions de plastes photosynthétiques. La présence ou l’absence de cyanobactéries endosymbiotiques est une différence majeure entre ce que l’on appelle, au sens large, végétaux et animaux (voir Selosse et Selosse & Loiseau-de Goër). À l’échelle de l’organisation pluricellulaire, les symbioses sont notamment les associations lichéniques, les mycorhizes et les nodosités fixatrices d’azote. Elles ne présentent guère d’équivalent parmi les animaux en dehors de quelques invertébrés marins hébergeant des algues chlorophylliennes unicellulaires. Certains biologistes à tendance scientiste refusent la notion de symbiose, dans laquelle ils croient deviner un optimisme qu’ils imaginent nécessairement finaliste : de tempérament peut-être pessimiste, ils voient de " prétendues symbioses " dans ce qu’ils préfèrent appeler parasitisme réciproque.
Un cas étrange est celui des galles, les zoocécidies, dont la structure est si précise, si délimitée, qu’elles constituent des objets biologiques en soi et dont on a écrit des milliers de sortes. La plante réagit à la présence du parasite en lui construisant un habitat fait de tissus végétaux qui protège la larve et qui, de surcroît, la nourrit comme si la plante se sacrifiait pour faire vivre son parasite ; risquons une comparaison déplacée : le pélican d’Alfred de Musset s’offre en nourriture à ses petits, or l’ensemble de la galle avec son insecte a été comparé, dans certains cas favorables, à un fruit contenant des graines. Cependant, soulignons-le, jamais la zoocécidie ne ressemble morphologiquement au fruit de la plante hôte. Surtout, problème pour le néodarwinisme, puisque cette organisation hautement complexe ne présente pas de réciprocité du bénéfice ni, par conséquent, de la valeur sélective, puisque cette interaction des deux partenaires n’est pas une symbiose typique, pouvons-nous supposer qu’il s’agisse d’une sorte de mimétisme, dans lequel, par exception, la dupe serait une plante ? La plante dupée se comporterait-elle à l’égard de son hôte indésirable comme si c’était sa propre progéniture ? En simplifiant à l’extrême, le jeune parasite déclencherait-il à son profit, par automatisme, dans les tissus végétaux qui l’hébergent, une série de processus moléculaires et morphogénétiques homologues de ceux qui se déroulent normalement dans les tissus ovariens après la fécondation de l’oosphère ? ou du moins (puisqu’en réalité la cécidie ne ressemble pas au fruit) une série de processus intervenant normalement dans le développement de la plante ? Dans cette hypothèse, la sélection naturelle ne pourrait éliminer ce phénomène désavantageux sans abandonner des systèmes de nécessité primordiale.
Les coadaptations entre animaux et végétaux sont nombreuses, concernant la pollinisation ou la dispersion des semences : l’animal sert de véhicule à un organisme peu mobile par lui-même, dont il commence par se nourrir. Cela a des implications morphologiques ; il suffit de regarder un insecte butineur marcher sur un capitule pour comprendre que la condensation des inflorescences a une valeur fonctionnelle et qu’elle a pu constituer une tendance de l’évolution. Ce qu’une fleur a d’agréable pour les yeux et l’odorat de l’homme relève de cette coadaptation du végétal et de l’animal : parfum, corolle attractive, tendance de l'inflorescence à ressembler à une fleur. Les plantes de petite taille ont souvent leurs fleurs orientées (par la lumière ou la gravité) d’une manière qui favorise au maximum leur repérage par les pollinisateurs ailés, comme si elles étaient " faites pour " être vues d’en haut ; l’élégance d’une fleur zygomorphe a pour corollaire une adaptation particulière au transport du pollen par les animaux. Certains biologistes craignent de sentir dans le mot " adaptation " une idée finaliste ; on peut leur proposer " compatibilité ". Mais la différence est grande avec le cas des champignons, dont la couleur et l’odeur du carpophore, les particularités gustatives ou toxiques, nous semblent ne jouer aucun rôle évident par rapport au monde animal et n’avoir aucune valeur sélective ; grande aussi avec le cas des plantes anémogames ou anémochores, dont la nature n’a certainement pas sélectionné l’aspect visuel (situation à comparer par exemple à celle des animaux vivant à l’obscurité dans le sol, dans les cavernes ou dans les grands fonds marins).
On voit comment les caractères du végétal, tels qu’ils ont été définis plus haut, en particulier les faibles aptitudes au déplacement et les grandes aptitudes biochimiques, se traduisent, en fin de compte, par des particularités caractéristiques dans l’interface de l’écologie et de la physiologie et dans la vie de la biocénose. Nous ne développerons pas ici les implications sociales, fort différentes pour les animaux et les plantes, dont tous les naturalistes connaissent les retombées sur le développement même de la science (phytosociologie, géographie botanique etc.).
Autres conséquences plus passives de la rencontre du monde animal et des végétaux : l’utilisation des plantes comme source alimentaire (l’hétérotrophie, considérée plus haut) et aussi comme habitats ou comme source d’éléments permettant la confection des habitats.
Un réseau de nécessités
La plante se caractérise par une grande souplesse, une grande adaptabilité aux facteurs externes, une morphogenèse largement dominée par les signaux de l’environnement et une très grande capacité de synthèses, à partir de molécules non organiques. Le monde animal, on l'a dit, a perdu ou n'a pas acquis cette capacité particulière de synthèses, mais, n’étant pas encombré par un énorme appareil chlorophyllien, il a développé une plus grande autonomie à l'égard du milieu et une centralisation individuelle plus poussée, qui a débouché sur le psychisme.
À travers ce que nous venons de voir, il apparaît que du point de vue du " comportement " l’idéal pour la plante, son avenir dans l’optique de la sélection naturelle, serait en quelque sorte de devenir toujours plus grande, plus grosse, d’avoir toujours plus de matières de réserve, un idéal que l’on pourrait qualifier de bourgeois et de capitaliste : l’idéal de vie de l’animal serait plutôt celui du pirate. Cette comparaison concerne des cas limites de plantes pérennantes, comme l'arbre ou la plante à tubercules, et beaucoup moins les plantes herbacées annuelles, caractérisées par des semences résistantes souvent nombreuses et une reproduction fréquente. La pression de sélection n’a pas la même structure dans ces deux cas. Il ne faut pas oublier non plus la petite taille des bryophytes et des prothalles de ptéridophytes, ni le port très bas des plantes en coussinets vivant dans des conditions extrêmes.
Les particularités des deux règnes s’accompagnent de très grandes différences entre les étapes de l’évolution. Nous ne soulevons pas la question passionnante de la succession chronologique de ces étapes, qui n’est pas notre sujet. Pour les animaux prédominent la diversification des plans d’organisation de l’individu et le développement du système nerveux. Pour les végétaux, si l'on considère, en simplifiant et peut-être dans le désordre, la série cyanobactéries, rhodophycées, phéophycées, chlorophycées et autres végétaux verts, avec la prolifération foisonnante des espèces qui a accompagné chacune de ces étapes, il y a eu l'élaboration des divers types d'organisation de la cellule autotrophe : caractères propres à la cellule eucaryote, développement de l'équipement photoassimilateur, des organites de réserves amylacées, de l'appareil locomoteur (tout cela concerne l'évolution de l'autotrophie et de ses corollaires) ; il y a eu aussi le développement de l'organisation pluricellulaire (nous avons esquissé plus haut les questions relatives à la morphologie), une étonnante diversité des plans d'organisation parmi les thallophytes (les algues vertes par exemple), la colonisation des milieux terrestres (avec ses implications morphologiques et histologiques), la régression de la génération haploïde, la protection des appareils reproducteurs et des gamètes d’abord nus (de l’archégone primitif à l’ovule, l’ovaire, l’ovaire infère), la variété extrême des formes des plantes vasculaires, en relation avec l’habitat et le mode de vie, une complexe nutrition ionique.
Ce qui précède permet de supposer que pour les plantes l'occupation et l'exploitation de notre planète, avec la diversité qu'elle comporte, se sont réalisées, entre autres, grâce à la plasticité du génotype et du phénotype et, pour les animaux, grâce à la diversification du génotype, favorisée elle-même par la diploïdie généralisée.
Les deux règnes sont d’une certaine façon en correspondance l’un avec l’autre, puisque l’un se nourrit de l’autre. Mais il se trouve, du moins en apparence, que les végétaux, surtout les cormophytes, se ressemblent beaucoup plus entre eux que les animaux et d’autre part la disparité numérique est grande : on peut se demander s’il y a des raisons structurales à ces différences de nombres d’espèces, nombres que l’on a estimés par exemple à 30 000 champignons (et 16 000 lichens), 2 000 cyanobactéries, 16 000 algues, 23 000 bryophytes et 200 000 plantes vasculaires, pour 100 000 mollusques, 700 000 insectes, 45 000 vertébrés etc., peu importent les valeurs absolues, largement controversées : on parle aussi de nombres beaucoup plus élevés. Ces différences numériques sont d’autant plus remarquables que du point de vue de la biomasse (et plus encore du point de vue de la surface totale de l’ensemble des individus), c’est l’inverse : les végétaux représentent une très grande proportion de l’ensemble des êtres organisés ; alors que les plantes ont en moyenne un développement souterrain peut-être supérieur à celui de leurs parties vertes, le vert de la chlorophylle est bien la couleur qui symbolise la nature vivante et non pas le bleu de l’hémocyanine ni le rouge de l’hémoglobine.
Parmi les végétaux, le groupe le plus nombreux, celui des plantes vasculaires, correspond à des plantes non fondamentalement différentes les unes des autres, pour lesquelles alternent les générations haplophasiques et diplophasiques avec une nette prédominance de la diplophase, prédominance qui est à son maximum chez quelques algues et chez les animaux. Il est tentant de voir un déterminisme causal dans cette corrélation entre, d’une part, la prépondérance de la diploïdie ou sa non-prépondérance et d’autre part la diversification des groupes en un nombre d’espèces plus ou moins grand. Mais d’autres facteurs ont pu jouer : pour beaucoup de végétaux, la multiplication asexuée et la longévité des individus ou des clones réduisent la fréquence des générations sexuées, alors que pour les animaux l’aptitude aux déplacements, tout en étant un frein à la multiplication des espèces endémiques dans les isolats, peut favoriser des croisements, eux-mêmes susceptibles d’accélérer la diversification des espèces.
Y a-t-il une éthologie végétale ?
Les rythmes et les mouvements des plantes, aspects physiologiques de l’adaptation au milieu, sont en partie l’homologue de ce que les animalistes appellent le comportement, qui englobe à peu près les modifications temporaires, les adaptations temporaires (ou locales) de l’être vivant. Mais les mécanismes physiologiques des complexes rythmes-irritabilité-stimulation-mouvements (ou des complexes analogues) ne relèvent guère que de la neurophysiologie chez l’animal, alors qu’ils mettent directement en jeu l’organisation même de nombreux aspects de la vie végétale ; ils s’inscrivent aussi dans la morphogenèse de la plante, plus souvent que dans celle de l’animal : les tropismes déterminent des courbures durables ; le gravitropisme ne peut se dissocier des dorsiventralités par gravimorphose, ni le phototropisme de la photomorphogenèse d’un tissu palissadique, ni les mécanonasties des mécanomorphoses, ni les " patterns " spatiaux des patterns temporels ; de plus les organisations spatiales qui résultent de ces phénomènes sont souvent définitives. Nous insisterons un peu sur ces questions, qui nous paraissent insuffisamment évoquées dans la littérature scientifique, eu égard à leur imporance dans la vie des plantes.
La plante est asservie à des contraintes qui organisent et limitent son aptitude au mouvement ; il est nécessaire que son développement soit orienté, dans l’espace, par rapport aux anisotropies du milieu. Le champ de la gravité, l’orientation et les gradients de la lumière, polarisent les structures et orientent la morphogenèse, ou bien orientent des structures polaires préétablies ; un ajustement pourra se réaliser entre l’organisation de la plante et l’orientation du milieu (l’animal est plus autonome par rapport à ces contraintes).
Ces remarques sont valables pour les mouvements très variés du végétal : déplacements des organites à l’intérieur de la cellule, déplacements de l’organisme unicellulaire dans son milieu et, surtout pour les plantes pluricellulaires, mouvements d’orientation (de courbure) de la cellule, de la tige, de la feuille etc. On pourra se reporter aux ouvrages de Bünning, de Haupt, de Haupt & Feinleib, et aux publications de Pfeffer, Baillaud (1968,1975), Satter & Galston, Galston, ou encore Goujet-Raverat.
Si l’on considère par exemple les mouvements de courbure des végétaux, on peut concevoir une série à but didactique, établie suivant un ordre progressif des composantes endogènes, sans aucune visée phylogénique :
- mouvements désordonnés
- tropismes
- nasties sans rythme endogène
- comportements à rythmes endogènes régularisés par le milieu extérieur
- automatismes à rythmes endogènes spontanés non régularisables
par les rythmes externes naturels.
Comme mouvements désordonnés (considérés du point de vue des fonctions de relations avec le milieu extérieur) citons par exemple ceux des oscillaires. Le filament se balance ; on peut être sceptique sur la valeur fonctionnelle de la manifestation de ce mouvement stéréotypé. C’est un automatisme simple.
Les tropismes sont des orientations commandées par un facteur externe lui-même orienté ; ils conditionnent l’orientation de la plante dans l’espace. Les tropismes commencent par une étape de mouvement de courbure, dont le déclenchement dans le temps et le déroulement dans l’espace dépendent des repères extérieurs. Ils correspondent le plus souvent à une croissance inégale des différents côtés de l’organe, parfois à des variations réversibles des dimensions cellulaires.
Les nasties sont des mouvements déclenchés dans le temps par un signal qui n’est pas nécessairement orienté dans l’espace. Dans l’espace elles sont orientées par rapport à une structure préétablie de l’organe (ainsi une élévation de température fait ouvrir la fleur de certaines tulipes). On a comparé ce système à un réflexe, à la différence près qu’il n’y a pas d’intervention d’un système nerveux. En général les nasties ne sont pas des mouvements de croissance mais des mouvements de variations de turgescence, liés à un changement brutal de volume des cellules. Elles sont parfois très rapides.
On peut être tenté de classer ces mouvements en deux catégories, selon qu’ils sont " de croissance " ou " de variation " ; ce serait donner la première place au rôle de l’effecteur. On pourrait tout aussi bien les classer d’après l’agent déclencheur. Mais on sent bien que l’essentiel se situe entre la réception du signal et la réponse finale.
Il arrive que des mouvements programmés dans l’espace, comme les nasties, et asservis comme les nasties à une régulation de la part de signaux temporels, soient capables de se poursuivre et de se répéter, indépendamment de la survenue d’autres signaux temporels ; le stimulus exogène nécessaire déclenche non seulement un certain comportement mais aussi sa répétition plusieurs fois de suite ; c’est le cas de l’ouverture quotidienne d’un capitule de souci. On parle alors de rythmes endogènes et le système présente des analogies de forme avec les comportements instinctifs des animaux : un signal déclenche un enchaînement programmé d’éléments comportementaux plus ou moins définis d’avance. Les mouvements à rythmes endogènes régularisables par les rythmes extérieurs ou exigeant un stimulus déclencheur sont, dans l’ensemble, des nasties perfectionnées. Il arrive que le rythme de " veille " et de " sommeil " soit spontané mais en quelque sorte mis à l’heure par les signaux externes.
En dehors des phénomènes de mouvements, on peut comparer à des " instincts " certains phénomènes morphogénétiques végétaux de périodicités annuelles, même s'il n'est pas habituel de leur donner ce nom, généralement réservé à des phénomènes régis par le système nerveux des animaux. Dans la forme temporelle du phénomène, l'analogie est grande entre les comportements annuels pilotés par les divers signaux successifs qui caractérisent le déroulement de l'année, pour les plantes et pour les animaux.
Enfin les plantes peuvent s'animer de rythmes endogènes non régularisables par les périodicités extérieures naturelles ; c’est par exemple le cas des mouvements révolutifs des vrilles ou des tiges volubiles. Leur autonomie est à peu près complète, à la fois dans leur orientation (partiellement gravitropique), leur période, leur amplitude et leurs relations de phases avec les rythmes extérieurs. Du point de vue de l’organisation temporelle ils sont comparables au rythme cardiaque.
Cette série typologique purement didactique correspond-elle à une progression (encore une fois sans prétention phylogénique !) dans l’adaptation au milieu ? Certainement en ce qui concerne les derniers termes, les nasties et les mouvements à rythme endogène. En particulier le tout dernier est l’apanage des plantes grimpantes, qui sont particulièrement perfectionnées dans leurs fonctions de relations. Mais les tropismes qui affectent de manière durable la plante entière, le gravitropisme de la racine, le phototropisme de la tige, sont d’une nécessité primordiale, par rapport aux nasties, qui n’interviennent, de manière temporaire, que pour de menues parties de l’organisme.
En psychophysiologie animale, il est banal de distinguer une série de comportements et d’établir une hiérarchie entre eux. À la base se situent les activités non dirigées, les mouvements désordonnés, brownoïdes, des planaires ou des daphnies par exemple. Les comportements dirigés sont beaucoup plus instructifs.
Les plus simples d’entre eux sont les réflexes ; ce sont des phénomènes élémentaires, des éléments de comportements ; il s’agit d’automatismes déclenchés par un stimulus : la réponse comporte à la fois une orientation dans l’espace et une structure dans le temps qui sont purement endogènes ; seul le déclic est exogène. Ce que les animalistes appellent souvent des tropismes, ce sont, pour les végétalistes, des tactismes, c’est-à-dire non pas de simples orientations liées à une incurvation mais des déplacements, par rapport à un facteur externe orienté : cela ne change pas grand-chose concernant notre propos ; il s’agit du comportement de l’organisme entier, donc d’un phénomène intégré ; le stimulus est exogène, mais ce n’est pas un simple déclic temporel, parce que de plus il oriente la réponse dans l’espace.
Les instincts sont des comportements automatiques, comme les réflexes, mais plus complexes, organisés en enchaînements ; ils sont bien consécutifs à des stimulus exogènes, mais ces stimulus, pour agir, doivent correspondre à un moment d’appétence qui, lui, est endogène.
Le mot " instinct ", terme ancien que les zoologistes refusent souvent d’utiliser, est cause de malentendus en biologie animale : il a été employé pour désigner une entité immatérielle guidant le comportement de l’organisme et constituant, de manière stérile, l’explication définitive d’un phénomène. Pour la comparaison animaux-végétaux, nous considérons, nous l’avons dit, que les signaux externes déclenchent par automatisme des enchaînements d’unités comportementales.
Là s’arrêtent les phénomènes pour lesquels plantes et animaux peuvent être mis en parallèle. Que constatons-nous si nous essayons de continuer nos comparaisons ?
Pour l’animal un ensemble de comportements plus perfectionnés que les instincts est constitué par les habitudes, qui sont acquises par l’individu au cours d’un conditionnement ; une fois acquises, mémorisées, les habitudes sont certes endogènes en ce sens que leur déterminisme est actuellement interne, comme c’est le cas spontanément pour les instincts, mais elles résultent d’une participation beaucoup plus grande de l’individu lui-même. Les habitudes permettent le déclenchement par anticipation d’actes qui sans cela se produiraient (peut-être) plus tard. Mieux encore que ces comportements endogènes très élaborés, les animaux montrent aussi des comportements supérieurs qui appartiennent en propre à l’individu (à sa personne, si l’on peut dire), à ses initiatives, à sa mémoire structurée, peut-être à son intelligence. Ces phénomènes sont inconnus des végétaux.
Revenons à la série végétale de comportements classés par autonomie croissante. À la fin de cette série nous avons placé des activités profondément autonomes : les mouvements révolutifs des tiges volubiles et des vrilles, mouvements de tâtonnements systématiques, ayant pour résultat une exploration très efficace de l’espace. Le mouvement révolutif d’un liseron est orienté par rapport à la gravité, mais il n’y a plus besoin de déclic. À ce stade ultime, la plante développe ses aptitudes les plus primitives (rappelons le cas des mouvements que nous avions qualifiés de " désordonnés "). Il s’agit de comportements endogènes, foncièrement autonomes, et de dispositifs sensoriels extrêmement performants.
Ajoutons quelques mots sur la question absurde de l'intelligence de la plante.
Il n’y a pas de psychisme végétal
Le mot animalité, un peu vague, a une signification qui dépend du contexte. Lorsque l’on définit l’animalité par rapport à l’humanité, c’est le psychisme qui est en cause : l’animal a-t-il des sensations ? a-t-il conscience d’exister ? réalise-t-il des actes intentionnels ? Ce n’est pas notre problème. Mais il arrive au végétal de présenter des comportements dont les manifestations rappellent le cas de l’animal et il arrive au végétaliste de s’exprimer de manière équivoque. Pour ces raisons, nous nous étendrons sur ces thèmes un peu plus qu’ils ne le méritent réellement.
L’animal ignore le vertige devant l’infini du temps, il ne sait pas que derrière tout visage il y a une tête de mort et qu’il est biodégradable. La plante ignore davantage encore, si c’est possible, les angoisses métaphysiques ; les lis du champ ne connaissent pas les soucis du lendemain. Seule concession, à titre de plaisanterie peut-être, à ceux qui voudraient chercher s’il y a du psychisme dans les végétaux : attendons déjà de savoir de manière sûre " en quoi " est faite la conscience, si elle consiste en une propriété des synapses ou en une propriété d’un fluide ou d’un cristal liquide relié aux synapses ou si elle est substantiellement immatérielle au sens où nous pouvons entendre ce mot.
Sans chercher à le démontrer, nous n’hésitons pas à l’affirmer : faute de neurones, de système nerveux central et de structure cérébrale, la plante est foncièrement inapte à toute activité intellectuelle ; elle ne peut avoir conscience de ce qu’elle fait. À supposer qu’elle " pense ", du moins elle ne le " sait " pas. On peut soutenir que l’animal est un animal-machine, mais dans cette hypothèse, plus encore, la plante est une plante-machine. Cette réserve étant faite pour éviter tout malentendu, on peut étudier la manière dont la plante " se comporte " dans le temps et dans l’espace, par rapport à son environnement ; il s’agit d’une partie de ses fonctions de relations.
Les études favorables à la thèse du psychisme végétal sont toujours bizarres, surtout aux yeux des gens de sciences (voir par exemple Maeule, Hyatt Verrill, Goujet-Raverat, Booth). Il s’est trouvé des auteurs, comme le poète Maeterlinck, pour proclamer l'intelligence des plantes. On se reportera utilement au travail de Bünning (1959). Bien des publications contiennent des passages ambigus, où l'on ne sait pas trop ce qui est écrit au sens propre ou au sens figuré ; sans référence au contexte on ne sait pas ce que signifie une phrase comme celle-ci de Morren, parlant des plantes : " sensibles à l'influence des milieux ambiants, elles savent coordonner leurs mouvements. " (Elles " savent " ?) Il n'y a pas de risques de confusion, espérons-le, dans des formules qui sont sans doute de simples images comme : telle espèce recherche les lieux ombragés, telle autre préfère les sols calcaires.
Quand Backster met son détecteur de mensonges sur une plante, il dit constater que son Dracaena sait compter. Cette assertion permet de publier un livre à succès et de gagner de l’argent. Mais la Science ne gagne rien à ce genre de bouffonnerie, même si le public crédule est heureux d’acheter du rêve à son libraire.
La plante présente des ondes de dépolarisation qui jouent un rôle important dans la vie de l'individu ; il arrive qu’un traitement par le lithium l’empêche de répondre à un signal externe ; mais la plante est-elle capable de comportements comparables à des initiatives intelligentes ? À cet égard on peut citer quelques faits étranges : ainsi selon plusieurs chercheurs les vrilles, avant tout contact, paraissent bel et bien diriger leurs mouvements révolutifs d’exploration vers les supports qui se trouvent dans leur voisinage et l’on n’a pas réussi à définir par l’intermédiaire de quel vecteur matériel la présence du tuteur serait enregistrée, à distance, par la vrille (sa couleur, la lumière qu’il réfléchit, sa température, la chaleur qu’il peut rayonner) ; si la vrille était attirée par le support indépendamment des propriétés " organoleptiques " du signal qu’elle peut en recevoir, serait-elle influencée par la notion même de support à rechercher ? Son comportement traduirait-il un projet conscient ? Certains auteurs, étrangers aux exigences de la recherche scientifique orthodoxe (comme Booth, ou comme Joel Liljendahl, commenté et critiqué par W. Haupt, communication personnelle 1998), n'hésitent pas à répondre affirmativement à des questions de cette sorte ; mais A. et J. Tronchet, s'y refusent ; si leurs expériences sont confirmées, ils sont tentés par l'hypothèse d'un simple tropisme, non identifié. Du point de vue expérimental la première manière de voir peut passer pour une solution de facilité ; la seconde appelle de nouvelles expériences. L'attitude de l’éminent botaniste Henri Prat, à l’esprit brillant, conduirait peut-être à une troisième réponse fort problématique : si la plante avait une certaine forme d'intelligence, ce pourrait être une forme très lente, par exemple décelable par la projection accélérée de films de cinéma ; serait-ce à dire que si les plantes ont une âme, elle est toute petite ? Mais ceci est encore un autre débat !
La vigne-vierge grimpant sur une paroi dirige ses vrilles adhésives dans la direction de celle-ci, qu’elle soit verticale ou disposée comme un plafond : intentionnel ? non, phototropisme négatif, et T.A. Knight, dès 1812, d’affirmer " no intellectual power ". Aucun fait expérimental sérieux n’a pu étayer l’hypothèse de l’" intelligence ". On peut vraiment considérer la plante comme une " machine " ; cela permet aux biologistes de travailler sur du matériel végétal avec moins de scrupules (ou moins de difficultés) que sur des animaux : le moine Gregor Mendel a pu faire des expériences sur la génétique des pois qui lui auraient été plus difficiles avec des animaux ; les expériences pionnières sur les rythmes biologiques reposaient sur les végétaux, pour plusieurs raisons sans doute, mais peut-être l’expérimentateur se sentait-il plus libre devant une plante-machine que devant un animal ou un cobaye humain. De même, les gouvernements, qui se préoccupent du bien-être des volailles, se désintéressent à bon droit de celui des bonsaïs autant que de la libération des nains de jardin.
Remarques sur quelques mouvements des végétaux
Quand le chloroplaste rubané d'un Mougeotia s'étale à la lumière sous un éclairement faible et se met sur la tranche sous un éclairement fort, cela contribue à régulariser la quantité de lumière qu'il reçoit ; des faits analogues sont connus dans bien d'autres végétaux ; il y a là, pourrait-on croire, une optimisation de la photosynthèse, ayant une valeur sélective dans l'évolution. Or dans plusieurs espèces d’algues marines, Nultsch et ses collaborateurs ont montré que la position des chloroplastes et des phéoplastes est sans effet immédiat sur la photosynthèse ; selon eux, la position " lumière forte " est une protection contre des dégâts causés par l’éclairement intense ; elle a donc sur la photosynthèse un effet favorable à long terme. Mais Wolfgang Haupt pose deux questions : quel peut être " the aim " du mouvement provoqué par la lumière faible et les résultats de Nultsch peuvent-ils être généralisés, même aux plantes supérieures ? Il se demande : si la disposition " lumière faible " ne favorise pas la photosynthèse, si elle ne présente aucun avantage (actuel) pour la survie de l’espèce, ne serait-il pas plus économique, pour la cellule, de " renoncer " à son activité motrice inutile et coûteuse (sans doute faiblement) et de conserver toujours son chloroplaste dans la position " lumière forte " ? Une supposition logique a été formulée par Haupt : il s'agirait d'un comportement vestigial, présumé utile à une époque où des algues ancestrales hypothétiques avaient une photosynthèse insuffisante, rendant utile le changement de position des chloroplastes. Il reste à savoir, remarque l’auteur, pourquoi cette mobilité, devenue inutile, n'a pas été éliminée au cours de l'évolution. Si ce phénomène, au mécanisme complexe, répandu dans plusieurs groupes de végétaux, ne présentait réellement aucun avantage pour la survie des espèces actuelles, si l'hypothèse soutenue par Haupt était la seule disponible et ne pouvait être conservée telle quelle, on ne pourrait pourtant pas croire que la cellule agisse volontairement par une sorte de plaisir, contrairement à son propre intérêt ! Haupt pense lui-même à d’autres idées explicatives.
Les mouvements dits de veille et de sommeil des feuilles ont peut-être pour rôle, selon Bünning, d’éviter à la plante d’être trompée sur la longueur du jour par l’éclairement nocturne de la Lune. Pour que ce phénomène ait une valeur sélective, ne faudrait-il pas s’assurer que les plantes en question ont une réelle réactivité photopériodique ? Justement Bünning l’a vérifié dans plusieurs cas et plusieurs expériences ont montré une légère réponse photopériodique à la lumière lunaire (Kadman-Zahavi & Peiper, cités par Salisbury & Ross). Mais certains auteurs affirment que l’éclairage lunaire est beaucoup trop faible pour jouer un tel rôle, rôle susceptible d’être modifié selon l’inclinaison des limbes foliaires.
Les capitules de Taraxacum effectuent des mouvements d’ouverture et de fermeture qui ont des conséquences sur l’activité des insectes pollinisateurs ; le pissenlit est une plante mellifère aux grandes corolles très visibles ; l’entomogamie est un remarquable instrument de la fécondité croisée qui joue elle-même un rôle essentiel dans la survie et la diversification des espèces ; mais les semences de cette plante apomictique se développent sans fécondation préalable : il y a là un faisceau de phénomènes complexes dont la valeur sélective actuelle n’est pas forcément très claire (système vestigial ? éventualité de vraies fécondations exceptionnelles ?) N’allons pas considérer le pissenlit comme un simple bienfaiteur des insectes.
On est parfois déçu de lire les raisonnements des auteurs anciens sur les notions de finalité et de non-finalité en biologie (voir F.A.F.C. Went). Mais un des buts de la physiologie est bien de connaître les conséquences des phénomènes dans la vie de l’organisme ou, si l’on préfère, leur rôle dans les " fonctions biologiques " ; un des moteurs de la recherche est de faire comme si l’on croyait à leur finalité et de tenter de l’expliquer : finalité-comme-si.
Certaines nasties sont très " perfectionnées ", du point de vue de la vitesse en particulier : ce sont des mouvements de variations de turgescence, dus à un changement brutal du volume des cellules, manifestés par exemple par le Dionaea muscipula, une plante insectivore, et aussi par la sensitive, Mimosa pudica ; pour cette dernière, le rôle adaptatif du mouvement est souvent mis en doute ; selon Bünning il faut voir la plante en pleine terre pour comprendre ce rôle : il s’agirait bel et bien d’une réaction de défense, par camouflage, comme nous l’avons mentionné plus haut : un animal arrive, ébranle la végétation, et brusquement toutes les folioles de la sensitive se rabattent, ce qui réduit immédiatement l’image qu’en perçoit l’animal. Il est curieux de constater que ces deux types de nasties rapides, dans lesquelles interviennent de véritables ondes de dépolarisation, sont des cas où le végétal est en lutte rapide avec l’animal. Sans doute, par la forme de leurs manifestations, ce sont encore des réflexes, mais parmi les plus spectaculaires du monde des plantes.
Les palpeurs, détecteurs, capteurs (dispositifs sensoriels ?) du végétal et les signaux
Il suffit de regarder un végétal se développer pour constater qu’il s’oriente par rapport à la gravité, à la lumière, parfois par rapport aux gradients d’humidité, de température, d’éclairement, aux sources de la lumière, au plan de polarisation de la lumière, aux champs électriques. Sa forme est commandée par ces agents ; dans plusieurs cas on a pu montrer que la germination de la spore ou du zygote est orientée par de tels facteurs externes. Le végétal est organisé dans le temps par rapport au rythme des jours et des nuits, à celui des saisons, parfois au rythme des marées. On doit bien admettre qu’il possède les dispositifs appropriés à la réception des signaux correspondants (voir par exemple Noll, Haberlandt, Galston, Tronchet et aussi Goujet-Raverat).
La plante " sent "-elle ces facteurs externes ? La question n'est pas anodine ; on n'a pas besoin d'y répondre ; la plante est peut-être capable de souffrir, mais peu importe, ici encore, si elle n’en a pas conscience. Vocabulaire mis à part, le physiologiste qui ne veut pas risquer de s'embarquer dans des considérations fumeuses ne prétend pas mesurer la sensibilité de la plante (qu’en savons-nous ?) mais son aptitude à réagir aux signaux, sa réactivité, qui est une donnée objective. Ainsi Jean-Claude Fondeville étudie la photoréactivité de la sensitive.
Parmi les actions du milieu, il faut veiller à ne pas prendre les apparences pour des facteurs physiques bien délimités. Au XIXe siècle, on étudiait le géotropisme et l’héliotropisme, exceptionnellement le sélénotropisme ; on préfère parler du gravitropisme et du phototropisme. Ces détails de vocabulaire recouvrent des préoccupations épistémologiques fondamentales pour la connaissance des appareils récepteurs de signaux. De manière analogue on risque de se fourvoyer si l’on montre que la vie d’une plante est conditionnée par l’" altitude ", même si l’on pense voir là une manière d’" intégrer " l'ensemble des facteurs du milieu, parce que c’est l’identification de chacun des facteurs qui a des chances de permettre celle de leurs récepteurs et des enchaînements correspondants.
Enfin, pour un comportement donné, on veillera, bien sûr, comme nous l’avons vu plus haut, à ne pas confondre le facteur externe responsable du signal déclencheur avec le facteur externe impliqué dans la valeur sélective (la nécessité) de ce comportement (par exemple le gravitropisme de la racine : adaptation à l'alimentation en eau de la plante, celui de la tige : adaptation à la réception de la lumière) ; par exemple aussi pour les phénomènes saisonniers : le signal durée du jour peut préadapter à la température froide à venir.
Retenons que les aptitudes détectrices de la plante sont très analogues aux aptitudes sensorielles des animaux en ce qui concerne les signaux susceptibles d’être reçus, comme l'orientation de la lumière et de la gravité, les effets mécaniques (toucher, c'est-à-dire compression et peut-être, pour la plante, choc ou blessure), la température (variations dans le temps, gradients dans l'espace), le repérage de la durée du jour et de la nuit etc. Des pigments sont les premiers récepteurs dans les stimulations phototropiques ou photopériodiques des végétaux ; des statolithes comparables aux otolithes participent au repérage par rapport à la gravité ; les compressions sont enregistrées par des cellules déformables à paroi fine ; la réception des stimulus thermiques met en jeu des différences de réactivité aux variations de température. Les appareils récepteurs ne sont pas toujours les mêmes que pour les animaux, mais la différence essentielle porte sur la présence ou l'absence d'un système nerveux intercalé entre la réception du signal et la réponse de l'organisme, système nerveux qui permet la vision binoculaire et l’audition binaurale réservées au monde animal et qui, surtout, autorise les " sensations " et ce qui s’y rattache.
Les messages
Dans un ouvrage publié en français l'année même de sa mort, Charles Darwin, en collaboration avec son fils Francis, montrait que les plantules de graminées s'incurvent vers la lumière par leur base, sauf si l’on cache leur sommet dans un capuchon opaque ; il concluait qu'une influence se propageait du sommet vers la base de l'organe. C'était le point de départ d’une succession de découvertes conduisant à la mise en évidence des hormones de croissance des plantes : domaine immense comme l’a montré Pilet, dont l’importance tient à la fois à la diversité des hormones que l’on connaît aujourd’hui et à la multiplicité des phénomènes réglés par elles. L’hormonologie des plantes présente des caractères liés à la relativement faible diversification des tissus végétaux, au fait que chaque organe ou tissu intervient souvent dans plusieurs fonctions et au rôle prédominant de la croissance dans les activités vitales du végétal. Wolfgang Haupt le souligne : alors que les hormones animales sont généralement produites dans des organes glandulaires spécifiques et règlent des processus spécifiques, au contraire les hormones végétales sont produites dans des cellules non spécifiques et agissent chacune sur des phénomènes très divers : la fonction réglée par l’hormone dépend du programme de la cellule réceptive. D’autre part, quand on examine certains tropismes végétaux on voit que l’hormone fonctionne comme régulateur seulement si le niveau d’hormone dans les tissus n’est pas saturé, donc si l’hormone produite est détournée de son action. De même, les régulations morphogénétiques signal—réponse se présentent souvent (Baillaud 1995, 1998a) comme des inhibitions, d’autant plus marquées que la plante est plus chétive, contrairement à ce que pourrait laisser prévoir la loi des facteurs limitants.
Le physicien indien Jagadis Chunder Bose tourna le dos, dit-on, à la physique proprement dite, après avoir eu l'impression d'être spolié par Guglielmo Marconi d'une découverte qui valut le prix Nobel à ce dernier ; il se lança alors dans la physiologie végétale, dans l’électrophysiologie, motivé sans doute par une philosophie qui l'incitait à considérer la plante comme un être sensible au sens le plus large du terme. Il montra des analogies étonnantes avec les potentialités nerveuses des animaux. Ses appareils enregistreurs étaient plus précis qu'exacts, mais il posa les fondements d'une étude électrophysiologique de la plante ; comme dans le cas des nerfs, il s'agit d'ondes de dépolarisation. Chez les végétaux, la circulation de ces ondes est au moins cent fois plus lente que chez les animaux. La circulation des messages se réalise soit par les vaisseaux du xylème (Rhodes & coll. 1996) soit par des cellules banales, différence flagrante par rapport aux animaux.
Nous devons à W. Haupt (1976) une présentation très enrichissante de l'enchaînement du signal à la réponse, qui concerne aussi bien la physiologie des mouvements que la morphogenèse végétale, selon un schéma qui a été largement développé depuis lors. La croissance typiquement indéfinie de la plante, permise par les méristèmes, facilitée par la dédifférenciation et jouant un rôle essentiel dans la compétition biologique, s'accompagne de la multiplication des éléments constitutifs de l'organisme ; les corrélations de la morphogenèse végétale, les interactions dans la croissance et le développement des divers organes, se présentent comme tout à fait différentes de ce qui se passe dans la plupart des groupes animaux, par exemple en ce qui concerne la dominance d'un bourgeon terminal sur les bourgeons latéraux, la stimulation ou l'inhibition d'un bourgeon à l'aiselle d'un cotylédon etc. Elles ont été considérées d'abord comme des complémentarités ou des concurrences trophiques, puis comme liées à des transports de substances non identifiées, puis comme dues à des hormones (auxines, gibbérellines etc.) ; cela a donné lieu à une énorme quantité de résultats expérimentaux ; la question a été abordée sous un nouvel angle par la référence à une succession signal — réception du signal — transformation du signal en message — transmission du message — réception et traduction du message — réponse de l’effecteur (Champagnat & Desbiez), dans laquelle les mécanismes peuvent être très variés, avec, au moins dans certains cas, une onde de dépolarisation comme support de la transmission du message, ou (et) une onde de pression hydraulique (Malone), et parfois des phénomènes de mise en mémoire de l'information (voir Desbiez, Mikulecky & Thellier ; Desbiez, Tort & Thellier ; Verdus, Thellier & Ripoli).
À propos des messages, de leur transduction et de l'excitabilité des cellules, on pourra notamment se reporter aux travaux de Boyer (1967), Boyer, Desbiez, Hofinger & Gaspar ; Boyer, Penel & Thonat ; Champagnat & Desbiez ; Moyen, Fleurat-Lessard & Roblin ; Stoeckel et Malone et à ceux de l’école toulousaine de Boudet et de Ranjeva. Ce domaine est en plein développement.
La plante a-t-elle de la mémoire ?
On voudra bien admettre qu'il s'agit ici, au maximum, d'une mémoire au sens de celle d'un ordinateur.
Fondeville, observant et commentant un phénomène de rythme endogène, persistant près de trois jours en lumière continue, phénomène du type de l’horloge physiologique de Bünning et que nous venons de comparer à un instinct, écrit que le problème de la " mémoire " au niveau du protoplasme pourrait être envisagé dans le cadre de l’étude de l’information à l’échelle moléculaire.
Dans presque tous les cas, si une plante a un rythme d’activité capable de persister en conditions uniformes, cette période est déterminée de manière congénitale. Pauvre mémoire, qui ne saurait retenir qu’une seule durée de période (Baillaud 1966b). Bien des efforts ont été cependant dépensés pour faire apprendre à une plante un rythme d’une période arbitraire décidée par l’expérimentateur (une demi-heure par exemple). Les résultats prétendument positifs sont les uns sûrement erronés, les autres probablement. On jouerait sur les mots en faisant appel ici à l’" unité profonde " qui, écrit Jean Delay, " relie l’instinct, mémoire de l’espèce, à l’habitude, mémoire de l’individu ". En matière de rythmes biologiques, on pourrait donner le nom de " mémoire " non pas à la persistance de la périodicité, mais aux conséquences, sur plusieurs jours, de la mise en phase des rythmes endogènes par rapport aux rythmes externes.
La plante peut conserver longtemps la trace des conditions où elle a vécu dans son propre passé (il s’agit des modifications durables, Dauermodifikationen, des physiologistes) mais ce phénomène rudimentaire ne mérite peut-être pas le nom de mémoire. Dans de nombreux cas, un signal est reçu par la plante, une information est mise en réserve et la réponse aura lieu plus tard, lorsque les circonstances s’y prêteront : il en est ainsi de signaux comme celui du froid pour la levée de dormance ou pour la vernalisation. " mémoire " si l’on veut, mais qui ne sert qu’une fois, à la différence de celle, plus classique, d’un animal ou d’un ordinateur. Il en est de même de la " mémoire " caractérisée mais fruste qui a été mise en évidence par M. Thellier & coll. Un signal (piqûres) donné sur un cotylédon d’une plantule est enregistré et entraînera une réponse morphogénétique plus tard, au moment choisi par l’expérimentateur, qui, par une décapitation adéquate et l’emploi d’un milieu appauvri en ions permettra à cette réponse de se manifester. Bien sûr il ne s’agit en rien d’un phénomène d’ordre mental. De tels phénomènes ont été rapprochés de l’effet Münchhausen. Le célèbre baron raconte que son postillon avait soufflé dans son cor, par grand froid, sans émettre aucun son ; il arrive dans une auberge et le cor, réchauffé, donne toute la musique qui s’y était trouvée congelée. De même, Brauner et Hager ont soumis des plantules à des stimulations gravitropiques, au froid, sans réponse de courbure ; puis, les plantules étant placées dans une atmosphère plus chaude, elles réalisent la courbure qui avait été préalablement induite. Le phénomène a été décrit par Thomas & Ebrey pour la réaction de croissance du Phycomyces consécutive à un stimulus lumineux. Haupt a observé une telle mise en réserve d’une information chez l’algue Mougeotia. " Mémoire ", ce maintien de la chaîne qui va du signal à la réponse, malgré le délai intercalé ? Peut-être, mais bien rudimentaire.
Et les autres aspects de la biologie ?
Le thème de cet article se prêterait à des développements nombreux à l’excès, concernant de multiples aspects de la biologie végétale et leurs interrelations, s’il est vrai que tout est dans tout et réciproquement. Il serait intéressant de comparer les modalités et les mécanismes de la croissance des cellules végétales et animales, le rôle des hormones, des récepteurs, des cofacteurs, le rôle des signaux de régulation et leur transduction, les mécanismes du clonage, les déterminismes de la sexualité, les implications de l’alternance des phases sur le cycle du développement et l’alternance des générations, d’insister sur la structure des ADN et des mitochondries, d’évoquer certains chapitres du génie génétique, également l’évolution des êtres vivants, les progrès dans la connaissance du darwinisme, d’insister sur la " finalité de fait ", et ceci n’est pas limitatif. La végétalité, telle que nous avons tenté de la cerner, se retrouve-t-elle de manière cohérente dans tous ces aspects de la vie des plantes ? Nous présumons que oui et qu’il reste seulement à le démontrer. Que l’inachèvement de ce travail incite le lecteur à continuer sa réflexion et à me transmettre ses remarques ! Je remercie dès maintenant Mmes Pierrette Baldy, Nicole Boyer et Arlette Nougarède, Mlles Liliane Denis et Maryse Tort, le père Gildas Beauchesne, MM. Alain Boudet, Bernard Boullard, Paul Champagnat, Jean-Claude Courduroux, Robert Gorenflot, Francis Hallé, Wolfgang Haupt, René Heller, Bernard Millet, Paul Nicolas, Paul-Émile Pilet et Michel Thellier de leurs avis très précieux. Mais j’assume la responsabilité des erreurs et des maladresses susceptibles d'être contenues dans les pages qui précèdent, et des lacunes aussi.
Conclusion ?
Le monde végétal est bien un ensemble en soi ; certes beaucoup d'angiospermes ont besoin d'animaux pour vivre, mais leur comportement global apparaît comme un enchevêtrement d’interactions aux limites nettes ; il est commandé par la contrainte de la rigidité cellulaire, qui entraîne l'inaptitude au déplacement, d'où la nécessité de l'autotrophie, qui entraîne aussi l'avantage donné au grandissement de l'organisme (donc à la présence du système vacuolaire), à la croissance indéfinie et donc à l'existence des méristèmes. On pourrait aussi bien dire que l'autotrophie a permis le non-déplacement et ainsi de suite. Il y a là un réseau de nécessités, dont les caractéristiques ont été rendues plus originales encore par la colonisation des terres émergées et le développement des " plantes " proprement dites. Sans vouloir reprendre tous les points soulevés dans cet article, nous avons vu que plusieurs particularités importantes des végétaux se rattachent à l'un ou l'autre élément de ce réseau.
Tout en restant dans l'optique de la plante-machine, nous assimilons à des faits d'éthologie les adaptations aux anisotropies spatiales et aux variations temporaires, cycliques ou non, du milieu ; ces phénomènes mettent en jeu des capteurs d'informations qui sont le point de départ de messages puis de réponses par variations métaboliques, mouvement ou morphogenèse, dont l’ensemble s’intègre dans le schéma précédent.
Nous pensons pouvoir considérer tout cela comme une des clés des différences du comportement écophysiologique des végétaux par rapport aux autres êtres vivants et comme une base de la notion de " végétalité " .
Références
On n’a pas cherché à renvoyer le lecteur aux divers ouvrages traitant de la vie des plantes édités en France et communément disponibles en librairie.
ASPP (1977) ASPP’S, 12 principles of plant biology, Newsletter Am. Soc. Plant Physiologists,
vol. 24, nr. 5, sept/oct., p. 18.
Auriac M. C. (1987). Contribution à l'étude de la pénétration des sucres dans les cellules assimilatrices chez le Crosne du Japon (Stachys sieboldi Miq.) Thèse Univ. Clermont II, 138 p.
Auriac M. C. & Tort M. (1985). Ultrastructural evidence for a direct transport from apoplast to vacuoles in the storage cells of Japanese Artichoke. Physiol. vég., 23, p; 301-307.
Auriac M. C. & Tort M. (1988). Quelques caractéristiques de la pénétration du saccharose et du galactose dans les cellules accumulatrices des tubercules de Crosne du Japon. C .R. Ac. Sc. Paris, 307, sér. III, p. 157-162.
Baillaud L. (1962). Mouvements autonomes des tiges, vrilles et autres organes, à l’exception des organes volubiles et des feuilles. In : W. Ruhland, Handbuch der Pflanzenphysiologie, p. 562-634, Bd. XVII, E. Bünning, Physiologie der Bewegungen, Teil 2. Berlin-Göttingen-Heidelberg, Springer-Verlag.
Baillaud L. (1963). Rythmes biologiques et civilisation. La leçon des plantes, Vitalstoffe-Zivilisationskrankheiten, 8, p. 213-215.
Baillaud L. (1966a). Le mémoire de Charles Darwin sur les plantes grimpantes. Arch. intern. Hist. des Sciences, 19, n° 76, p. 235-246.
Baillaud L. (1966b). Les rythmes biologiques et la mémoire. Gazette méd. France, 73, p. 4869-4878.
Baillaud L. (1968). De la vie végétale à la vie animale : les tropismes, les réflexes et les comportements autonomes. Vitalstoffe-Zivilisationskrankheiten, 13 (1) p. 19-21.
Baillaud L. (1975). Y a-t-il une éthologie végétale ? Réflexions introductives sur les mouvements, les rythmes et l’irritabilité des plantes. Comptes rendus du 99e Congrès national des Sociétés savante, Besançon 1974, fasc. 2, p. 17-22.
Baillaud L. (1995). Les systèmes de régulation de la morphogenèse masqués par la vigueur de la plante. Bull. Soc. Écophysiologie, 20 p. 83-86.
Baillaud L. (1998 a). Morphogenèse et vigueur de la plante : non-respect de la loi des facteurs limitants dans les régulations signal-réponse. Phytomorphology, 40 (3) p. 273-279.
Baillaud L. (1998 b). Structures cycliques dans l’espace et dans le temps : cas des végétaux. Bull. Gr. Ét. Rythmes biol., Rythmes, 30 (3-4), p. 9-28.
Baillaud L. (1999). Structures répétitives spatiales et spatio-temporelles des plantes. Phytomorphology, 49 (4), p. 377-404.
Baillaud L. & Courtot Y. (1956). Observations sur quelques nodes de cicatrisation chez les végétaux vasculaires. Ann. sci. Univ. Besançon, 2e série, Bot., 8, p. 63-72.
Baldwin I.T. & Schultz J.C. (1983) Rapid changes in tree leaf chemistry induced by damage : evidence for communication between plants. Science, vol. 221, nr. 4607, p. 277-279.
Barrett S. (1987). Le mimétisme chez les plantes. Pour la Science, n° 12, 1, p. 72-80. Commentaire de L. Baillaud p. 81.
Bézanger-Beauquesne L. (1975). Contribution des plantes à la défense de leurs semblables. Bull. Soc. bot. France, t. 102 n° 9, p. 548-575
Bonner J.T. (1965). Morphogenetic movements in plants. In : W. Ruhland, Handbuch der Pflanzenphysiologie, Bd. XV, A. Lang, Differenzierung und Entwicklung, Teil 1, p. 492-503, Berlin-Heidelberg - New-York, Springer-Verlag.
Booth G. (1955). An observation on psi function in plants. Parapsychol. For. 88-90.
Bowers W.S. (1997), Phytochemical defenses targeting insect behavior. Acta bot. Gallica, 144 (4), p. 383-390.
Boyer N. (1967). Modifications de la croissance de la tige de Bryone (Bryonia dioica) à la suite d’irritations tactiles. C.R. Ac. Sc. Paris, 264, p. 2114-2117.
Boyer N., Desbiez M.O., Hofinger M. & Gaspar T. (1983). Effect of lithium on thigmomorphogenesis in Bryonia dioica, ethylene production and sensitivity. Plant Physiol., 72, p. 522-525.
Boyer N., Penel C. & Thonat C. (1994). Le calcium et les calciprotéines dans la transduction du signal chez la bryone. In : Millet B. éd. (1994), Besançon, p. 69-73.
Bünning E. (1959). Allgemeine Gesetze und Phänomene der pflanzlichen Bewegungsphysiologie. In Bünning E. éd. (1959-1962) Teil I p. 8-23. Physiologie der Bewegungen. In : Ruhland W. éd. Handbuch der Pflanzenphysiologie, Berlin-Göttingen-Heidelberg, Springer-Verlag, Bd. XVII, Teil 1, XVI + 716 p., Teil 2, XXIV + 117 p.
Bünning E. (1977). Die physiologische Uhr, circadiane Rhythmik und Biochronometrie. X + 176 p., Berlin-Heidelberg-New York, Springer.
Champagnat P. (1992). Aspects morphogénétiques p. 177-461 de Côme D. éd. Les végétaux et le froid, Paris, Hermann, 600 p.
Champagnat P. & Desbiez M.O. (1994). L'évolution conceptuelle des recherches sur la physiologie des corrélations chez les plantes. In : Millet B. éd. (1994), Besançon, p. 55-68.
Delaporte F. (1979). Le second règne de la nature. 242 p., Paris, Flammarion.
Delay J. (1950). Les dissolutions de la mémoire. Thèse Lettres Paris 1942. 2e éd., XX + 152 p., Paris, P.U.F.
Desbiez M.O., Boyer N. & Thellier M. (1992). Les messages de croissance chez les plantes. La Recherche, 240, vol. 23, p. 188-196.
Desbiez M.O., Mikulecky D. & Thellier M. (1994). Growth messages in plants : principle of a possible modelling, and further experimental characteristics. J. biol. Sc., 2 (2) p. 127-136.
Desbiez M.O., Tort M. & Thellier M. (1991). Control of a symmetry-breaking process in the course of the morphogenesis of plantlets of Bidens pilosus L; Planta, 184, p. 397-402.
De Wildeman É. (1893). Le mouvement et la sensibilité des végétaux. 17 p., Bruxelles : Weissenbrugh imp.
Dumortier B.C. (1829). Recherches sur la motilité des végétaux. Messager des Sciences et des Arts, Gand, p. 115-126.
Ebrey T.G. & Clayton R.K. (1969). Phycomyces : stimulus storage in light-initiated reactions. Science, 164, p. 427-428.
Fondeville J.-C. (1964). Recherches sur la sensibilité, la motricité et les rythmes endogènes chez Mimosa pudica Linné, 174 p., Poitiers, Thèse Sciences.
Fondeville J.-C. (1968). Une plante cobaye : la Sensitive. 34 p. Paris, Palais de la découverte, A 339.
Galston A.W. (1975). The limits of plant power. Natural History, 84 (4), p. 22-24.
Galston A.W. (1976). The sensuous plant. Horticulture, LIV (8), p. 34-44.
Goldberg R.B. (1988). Plants : novel developmental processes. Sciences, vol. 240, 10 june, p. 1460-1467.
Goujet-Raverat J. (1950). Où la liane, le jasmin et la bryone font preuve d’"intelligence ". Le Progrès de Lyon, 24 janvier 1950.
Goujet-Raverat J. (1950). Géniale couleuvrée qui s’est dotée d’un sens tactile ! Le Progrès de Lyon, 31 janvier 1950.
Goujet-Raverat J. (1950). Mimosa pudica : la sensitive. Le Progrès de Lyon, 7 novembre 1950.
Greppin H. (1994). Des protéines comme organisatrices de la fréquence spécifique des rythmes circadiens ? In : Millet B. éd. (1994), Besançon, p. 29-35.
Grümmer G. (1955). Die gegenseitige Beeinflussung höherer Pflanzen. Allelopathie. 162 p. Jena, Gustav Fischer.
Haberlandt G. (1906). Sinnesorgane im Pflanzenreich zur Perzeption mechanischer Reize. 2. Auflage. 207 p. + IX pl. Leipzig, Engelmann.
Haupt W. (1976). La physiologie du mouvement est-elle encore un domaine de la science moderne ? Bull. Groupe Étude Rythmes biol, t. 8, n° 1, p. 7-40.
Haupt W. (1977). Bewegunsphysiologie der Pflanzen. Stuttgart, Thieme.
Haupt W. (1999). Chloroplast movement : from phenomenology to molecular biology. Progress in Botany, vol. 60, p. 3-36.
Haupt W. & Feinleib M.E. ed. (1979). Physiology of movements. In : Encyclopedia of plant physiology, new series, vol. 7, XVIII + 731 p., Berlin-Heidelberg-New York, Springer-Verlag.
Heckel É. (1875). Du mouvement végétal. Nouvelles recherches anatomiques et physiologiques sur la motilité dans quelques organes reproducteurs des Phanérogames. VIII + 163 p., IV pl., Paris, Masson.
Herr J.-M., Jr. (1999). On the origin of leaves : the telome theory revised. Phytomorphology, vol. 49, p. 111-134.
Hyatt Verrill A. (1948). Le monde étrange des bêtes et des plantes. 333 p., Paris, Payot.
Jackson A.O. & Taylor C.B. (1996). Plant-microbe interactions : life and death at the interface. The Plant Cell, 8, p. 1651-1668.
Jerebzoff S. (1994). Pour une évolution des idées en chronobiologie. In : Millet B. éd. (1994), Besançon, p. 37-43.
Kadman-Zahavi A. & Peiper D. (1987). Effects of moonlght on flower induction in Pharbitis nil, using a single dark period. Annals of Botany, 6, p. 621-623.
Kaplan D. & Hagemann W. (1991). The relationship of cell and organism in vascular plants. Are cells the building blocks of plant form ? Bioscience, vol. 441, nr. 10, november, p. 693-703.
Lefèvre J. Jbir N., Desbiez M.O. (1994). Variations journalières de la sensibilité à des signaux morphogènes chez Lycopersicon esculentum Mill. : influence des facteurs de l’environnement. In : Millet B. éd. (1994), Besançon, p. 45-53.
Lück H.B. & Lück J. (1994). De la théorie des automates vers la phyllotaxie. In : Millet B. éd. (1994), Besançon, p. 85-94.
Maeterlinck M. (1907). L’intelligence des fleurs. Paris, Fasquelle.
Maeule (1911). " Wille " und " Intelligenz " in den Lebensäusserungen der Pflanzen, Wiss. Beilage zum Programm des kgl. Gymnasiums in Stuttgart-Cannstatt, (Programm Nr. 825), 1-26.
Mairan J.J. Dortous de (1729). Observation botanique. Histoire de l’Académie royale des Sciences p. 35 [texte redécouvert et diffusé par E. Bünning vers 1960, reproduit dans Bull. Groupe Étude Rythmes biol. (1994), t. 26, n° 3, p. 4 de la couverture.]
Malone M. (1996). Rapid long-distance signal transmission in higer plants. Advances in botanical Research, vol. 22, incorporating Advances in Plant Pathology, ISBN 0 12-005922-3, p. 163-228.
Manachère G. (1994). Photomorphogenèse et photosporogenèse des carpophores de Coprinus congregatus : implication dans la régulation du rythme endogène de fructification (rythme de basse fréquence). In : Millet B. éd. (1994), Besançon, p. 17-27.
Millet B. éd. (1994). Mouvements, rythmes et irritabilité chez les végétaux. ISBN 2-905226-05 6, VI + 94 p., Besançon, Université de Franche-Comté.
Moreau R. & Schaeffer R.A. (1990). La Forêt comtoise. 349 p., Besançon.
Morren E. (1885). La sensibilité et la motilité des végétaux. Bull. Acad. roy . Sc. L. et Beaux-Arts de Belgique, sér. 3, t. 10, p. 851-900.
Moyen C., Fleurat-Lessard P. & Roblin G. (1994). Visualisation par cytofluorimétrie des modifications calciques induites par un éclairement laser à 360 nm dans les protoplastes de cellules motrices de Mimosa pudica L. In : Millet B. éd. (1994), Besançon, p. 11-16.
Noll F. (1896). Das Sinnesleben der Pflanzen. Ber. Senckenberg. Naturforsch. Ges. Frankfurt, p. 169-257.
Pelt J.-M. & Steffan F. (1996). Les langages secrets de la nature. La communication chez les animaux et les plantes. ISBN 2-213-59610-7, Paris, Fayard, 298 p.
Percival M.S. (1962). The mutual adaptation of bees and flowers. Bee World, 43 (4), p. 106-113.
Pfeffer W. (1893). De l’irritabilité chez les plantes. Archives Sc. phys. et nat., 3e période, t. XXX, p. 397-421.
Pilet P. É. (1963). La finalité de fait en biologie. Filosofia della Scienza, 21, p. 5-30.
Pilet P. É. (1994). Les auxines : émergences et diversification d’un concept. La vie des Sciences, C. R. Acad. Sc. (Paris), 11, p. 149-161.
Prat H. (1964). Le champ unitaire en biologie. XII + 154 p., Paris, P.U.F.
Purves W.H. Orians G.H. & Heller H.C., London J. trad., (1994). Le monde du vivant, traité de biologie, Paris, Flamarion Sciences.
Rhodes J. D., Thain J. F. & Wildon D. C. (1996). The pathway for systemic electrical signal conduction in the wounded tomato plant. Planta, 200, p. 50-57.
Roblin G. (1979). Mimosa pudica : a model for the study of the excitability in plants. Biol. Rev., 54, p. 135-153.
Salisbury F.B. & Ross C.W. (1992). Plant physiology 682 p., Belmont, California, Wadsworth Publishing Co., a Division of Wadsworth.
Satter R.L. & Galston A.W. (1973). Leaf movements : Rosetta stone of plant behavior ? Bioscience, July, p. 407-416.
Schnell R. (1994). Les stratégies végétales. X + 128 p., ISBN 2-225-84305-8, Paris, Masson.
Selosse M.-A. (1996). Les cyanobactéries, d’étonnants procaryotes autotrophes. Biologie Géologie 1996 n° 3,
p. 481-529.
Selosse M.-A. & Loiseau-de Goër S. (1997). La saga de l’endosymbiose, les mitochondries et les plastes, témoins et acteurs de l’évolution. La Recherche 296, p. 36-41.
Stoeckel H. (1994). À la recherche de protoplastes excitables. In : Millet B. éd. (1994), p. 75-83.
Thellier M., Desbiez M.O., Champagnat P. & Kergosien Y. (1982). Do memory processes occur also in plants ? Physiol. Plant., 56, p. 281-284.
Tort M. (1995). Fonctionnements cellulaires associés à la tubérisation. Acta bot. Gallica, 142 (4), p. 341-351.
Tronchet A. (1977). La sensibilité des plantes. VIII + 158 p., Paris, Masson.
Tronchet A. & Tronchet J. (1945). La nutation des vrilles est-elle influencée par les tuteurs ? C. R. Acad. Sc. (Paris), 221, p. 451-453.
Tumlinson J.H. & Vet E.M. (1993). How parasitic wasps find their hosts. Scientific American, vol. 268, nr. 3 (march), p. 46-52.
Verdus M.-C., Thellier M. & Ripoli C. (1997). Storage of environmental signals in flax. Their morphogenetic effect as enabled by a transient depletium of calcium. The Plant J., 12 (6), p. 1399-1410
Went F.A.F.C. (1907). Ueber Zwecklosigkeit in der lebenden Natur. Biolog. Centralblatt, Bd. XXVII. Nr. 9, p. 257-271.
Willmer P.G. & Stone G.N. (1997). How aggressive ant-guards assist seed-set in Acacia flowers. Nature, vol. 388, n° 6638 (10 july), p. 165-167.